Enlace Revista documento pdf
Sumario.-
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Vient de paraître : Le Bulletin célinien, n° 349.
Au sommaire :
Marc Laudelout : Bloc-notes
François Gibault : Le centenaire de Lucien Combelle
Pierre Assouline : Entretien avec Lucien Combelle (1988)
Philippe Alméras : Lucien Combelle relaps
Correspondance Combelle - Céline : "Révolution et révolutionnaires" (1942)
Lucien Combelle : L'heure est au pamphlet (1939)
Eric Mazet : D'un monument à l'autre
Frédéric Saenen : Albert Cossery, le sphinx
Abonnement : 55 euros à :
Le Bulletin célinien, Bureau St Lambert, B P 77, BE 1200 Bruxelles.
00:05 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, céline, revue |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Méridien Zéro a reçu Philippe Vilgier, auteur d'une passionnante biographie parue aux Editions Via Romana sur Jean Fontenoy, aventurier, journaliste et écrivain.
Cet homme hors du commun, au tracé de vie riche et iconoclaste, a été qualifié de "Malraux fasciste". C'est le portrait de ce personnage complexe et captivant que nous vous proposons.
A la barre : PGL
A la technique : Lord Tesla
Pour écouter:
http://www.meridien-zero.com/archive/2013/01/11/emission-n-127-jean-fontenoy-aventurier-journaliste-ecrivain.html
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Martin LICHTMESZ
Unmittelbar nach der Tat bezeichnete der deutsche Komponist Karlheinz Stockhausen den Terroranschlag vom 11. September 2001 als „das größte Kunstwerk, was es je gegeben hat“. Den Zusatz „jetzt müssen Sie alle Ihr Gehirn umstellen“ vorausgeschickt, sagte er im Wortlaut:
Daß also Geister in einem Akt etwas vollbringen, was wir in der Musik nie träumen könnten, daß Leute zehn Jahre üben wie verrückt, total fanatisch, für ein Konzert. Und dann sterben. Und das ist das größte Kunstwerk, das es überhaupt gibt für den ganzen Kosmos. Stellen Sie sich das doch vor, was da passiert ist. Das sind also Leute, die sind so konzentriert auf dieses eine, auf die eine Aufführung, und dann werden fünftausend Leute in die Auferstehung gejagt. In einem Moment. Das könnte ich nicht. Dagegen sind wir gar nichts, also als Komponisten. … Ein Verbrechen ist es deshalb, weil die Menschen nicht einverstanden waren. Die sind nicht in das Konzert gekommen. Das ist klar. Und es hat ihnen niemand angekündigt, ihr könntet dabei draufgehen.
Stockhausen kam damit trotz großer Empörung gerade noch davon – als Abgesandter des Sirius schützte ihn die Narrenfreiheit des Avantgardisten. Kurz darauf erregte auch der postmoderne Philosoph Jean Baudrillard erhebliche Irritation, als er in einem Artikel für die Tageszeitung Le Monde den Terroranschlag als eine Art Hyper-Event, als „Mutter aller Events“ beschrieb. Während noch alle Welt unter Schock stand, und in Deutschland betappert „Wir sind alle Amerikaner!“ gestammelt wurde, versuchte Baudrillard, die Tat mit kaltem Auge als Menetekel und Symbol zu lesen, an dem auch der selbstzerstörerische Trieb des Westens sichtbar werde.
Der Spiegel interviewte Baudrillard zu diesen Thesen:
SPIEGEL: Monsieur Baudrillard, Sie haben die Attentate vom 11. September in New York und Washington als das „absolute Ereignis“ beschrieben. Sie haben die USA beschuldigt, durch ihre unerträgliche hegemoniale Übermacht den unwiderstehlichen Wunsch nach ihrer Zerstörung zu wecken. Jetzt, wo die Herrschaft der Taliban kläglich zusammengebrochen ist, Bin Laden nichts mehr als ein gehetzter Flüchtling ist, müssen Sie nicht alles widerrufen?
Baudrillard: Ich habe nichts verherrlicht, niemanden angeklagt und nichts gerechtfertigt. Man darf den Botschafter nicht mit seiner Kunde verwechseln. Ich bemühe mich, einen Prozess zu analysieren: den der Globalisierung, die durch ihre schrankenlose Ausdehnung die Bedingungen für ihre eigene Zerstörung schafft.
SPIEGEL: Lenken Sie damit nicht einfach ab von der Tatsache, dass identifizierbare Verbrecher und Terroristen für die Anschläge verantwortlich sind?
Baudrillard: Natürlich gibt es handelnde Akteure, aber der Geist des Terrorismus und der Panik reicht weit über sie hinaus. Der Krieg der Amerikaner konzentriert sich auf ein sichtbares Objekt, das sie zerschmettern möchten. Doch das Ereignis vom 11. September in all seiner symbolischen Bedeutung lässt sich so nicht auslöschen. Die Bomben auf Afghanistan sind eine völlig unzulängliche Ersatzhandlung.
SPIEGEL: Warum können Sie nicht einfach akzeptieren, dass die Zerstörung des World Trade Center die willkürliche, irrationale Tat einiger verblendeter Fanatiker war?
Baudrillard: Eine gute Frage, aber selbst wenn es sich um eine bloße Katastrophe gehandelt hätte, bliebe die symbolische Bedeutung des Ereignisses erhalten. Nur so erklärt sich auch seine Faszination. Hier ist etwas geschehen, das bei weitem den Willen der Akteure übersteigt. Es gibt eine universelle Allergie gegen eine endgültige Ordnung, gegen eine endgültige Macht, und die Zwillingstürme des World Trade Center verkörperten diese endgültige Ordnung in vollkommener Weise.
SPIEGEL: Demnach erklären Sie den terroristischen Wahn als unausweichliche Reaktion auf ein System, das selbst größenwahnsinnig geworden ist?
Baudrillard: Das System selbst in seinem totalen Anspruch hat die objektiven Bedingungen dieses furchtbaren Gegenschlags geschaffen. Der immanente Irrsinn der Globalisierung bringt Wahnsinnige hervor, so wie eine unausgeglichene Gesellschaft Delinquenten und Psychopathen erzeugt. In Wahrheit sind diese aber nur die Symptome des Übels. Der Terrorismus ist überall, wie ein Virus. Er braucht Afghanistan nicht als Heimstatt.
Irgendwo in der Mitte zwischen Baudrillard und Stockhausen stossen wir auf den österreichischen Künstler und Medientheoretiker Peter Weibel, der vor einem Jahr in einem Interview mit dem Standard das Auftreten von Amokläufern und Attentätern in Europa als Symptome eines zerfallenden Systems deutete:
Das Problem ist: Je länger es dauert, bis das System implodiert, desto höher sind die Kosten. Die Armut wird steigen, damit steigt in der Gesellschaft das Konfliktpotential. Denken wir doch nur an die Attentate in Norwegen und Lüttich. Man kann es sich einfach machen und sagen: Anders Brevik und Nordine Amrani sind geisteskranke Individuen. Aber diese Attentäter nahmen Tendenzen, Slogans, Gedankengut auf. Brevik hat ein Manifest mit 1500 Seiten geschrieben. Und durch ihre psychische Kondition wurde dieses Gedankengut verzerrt. Amrani und Brevik hätten es aber nicht verzerren können, wenn nicht etwas zum Verzerren da gewesen wäre. Jetzt versucht man, Menschen wie Brevik zu isolieren – und übersieht, dass das Pathologische nicht in ihnen, sondern in der Gesellschaft ist. Sie sind nur das Fieberthermometer. Wenn wir nicht bald eine Lösung finden, werden solche Attentate zunehmen. Und das wäre für mich ein Symptom für die sich abzeichnende Instabilität des Systems.
Weibel ist ein Veteran des „Wiener Aktionismus“ - man begegnet ihm auch als Gesprächspartner Lutz Dammbecks in dessen legendärer Dokumentarstudie „Das Meisterspiel“ (1998), die unter anderem die alte Frage der Avantgarde nach dem Aufbrechen und Sprengen der traditionellen Grenzen der Kunst umkreiste.
Im Zentrum des Films stand ein Akt von ästhetischem „Terrorismus“: Ein unbekannter Täter war im September 1994 in das Atelier des als „Übermaler“ fremder Gemälde bekannt gewordenen Arnulf Rainer eingedrungen, und hatte dessen Bilder seinerseits mit schwarzer Farbe übermalt (wie übrigens auch einmal der „Pornojäger“ Martin Humer ein Bild von Otto Mühl „zugenitscht“ hat), eines davon mit der Persiflage eines Satzes aus der Autobiographie eines bekannten verhinderten Künstlers versehen, der sich später unter anderem in der „Ästhetisierung der Politik“ einen Namen gemacht hat, in großen roten Lettern:
Und da beschloß er, Aktionist zu sein.
Etwa ein Jahr später wurde der Polizei ein „Bekennerschreiben“ zugesandt, in der Tat eine kenntnisreiche, manifestartige Fundamentalkritik bestimmter Tendenzen der modernen Kunst. Ob tatsächlich der Autor des Traktats mit dem Übermaler des Übermalers identisch war, bleibt bis heute ungeklärt (manche vermuten, daß niemand anders als Rainer selbst hinter der Aktion steckte).
Zeitgleich wurde Österreich von einer geheimnisvollen Briefbombenserie mit fremdenfeindlichem Hintergrund heimgesucht, die ebenfalls von Manifesten (und sogar schwarzen Texttafeln) begleitet wurde. Das führte Dammbeck zu der Frage, ob es sich hierbei nicht auch um eine Art von blutiger „Konzeptkunst“ handeln könne.
Der 1953 geborene französische Romancier und Essayist Richard Millet steht also mit seinem im August des Jahres erschienenen Essay mit dem irritierenden Titel „Literarische Lobrede auf Anders Breivik“ durchaus in einer langen intellektuellen Tradition. Im Gegensatz zu Stockhausen und Baudrillard ist er aber nicht bloß mit einem blauen Auge davongekommen.
Alain de Benoist berichtete über die massive mediale Diffamierungs- und Ausgrenzungskampagne, die wider Millet einsetzte, und ihn schließlich seine Position als Lektor von Gallimard kostete (unter anderem hatte er die Herausgabe des Schlagers „Die Wohlgesinnten“ von Jonathan Littell maßgeblich mitverantwortet).
Über den Inhalt des Essays gelogen wurde auch in der deutschen Presse, die Millet übrigens bisher recht wohlgesonnen (no pun intended) war. Seinen Roman „Die drei Schwestern Piale“ (1998) pries die Süddeutsche Zeitung als „Kunstwerk von seltener Geschliffenheit und Eleganz“, und die Zeit lobte „Der Stolz der Familie Pythre“ (2001) für seine „klare und leuchtende Sprache“. Die Sprache und ihr Verfall zur Schablone der „Allgemeinheiten“ ist ein wesentliches Thema Millets: so seines Großessays „Langue Fantôme“ (Phantomsprache), zu dem die „Éloge littéraire“ nur eine kurze Bonusbeigabe ist.
In der Tat wird bei der Lektüre des inkriminierten Textes schnell klar, daß der Titel nicht nur ironisch, sondern geradewegs sarkastisch gemeint ist: in einer Zeit, in der die Sprache, die Kultur und die Literatur massiv verfallen und zerstört werden, kann man auch einen destruktiven Akt wie den Breiviks als „literarisch“ bezeichnen. Den Begriff der „Literatur“ faßt Millet dabei recht weit, gebraucht ihn geradezu synonym mit „Kultur“ selbst. In seinem Essay schreibt er:
Die Herrschaft der Zahl, der Multikulturalismus, die Horizontalität, der Taumel der Erschöpfung und der Verlust des Sinns, sowie das, was Renaud Camus die „Entzivilisierung“ nennt, zusammen mit seinem Korollarium, dem „großen Bevölkerungausstausch“: all dies bedeutet die Niederlage der Literatur.
In der aktuellen Jungen Freiheit (48/12) findet sich ein lesenwertes Interview mit Millet, in dem er den Hintergrund seines Aufsatzes erläutert:
Man muß sich dem Abscheulichen stellen, dem Unentschuldbaren. Dostojewski lieferte in den „Dämonen“ sehr gute Porträts von Monstern, Truman Capote in „Kaltblütig“. Von Breivik zu sprechen bedeutet also eine Methode, um vom Bösen zu sprechen. Ist das nicht die Aufgabe des Schriftstellers? (…)
Breivik ist ein verfehlter Schriftsteller – er selbst definierte sich im Laufe seines Prozesses als Schriftsteller. Meine „Eloge“ ist offensichtlich ironisch. Breivik symbolisiert den Tod der europäischen Kultur. Ich wollte zeigen, daß Literatur und noch viel mehr Kultur im Abendland keinen Wert mehr besitzen und daß es der Tod derselben ist, der das Vordringen des Multikulturalismus ermöglicht. Breivik und der Multikulturalismus verkörpern den Tod der Literatur insoweit, als daß letztere eine der gehobensten Ausdrucksformen dieser Kultur ist.
Breivik und sein algerisch-islamisches Pendant Mohammed Merah, der im März 2012 in Frankreich sieben Menschen erschoß, darunter drei jüdische Kinder, nennt er
…. Kriminelle, die die Schuld verbrecherischen Denkens zu Fragen der Nation und der Zivilisation tragen. Während Merah zum Dunstkreis
des internationalen islamischen Terrorismus gehört und Breivik zur Dekadenz, die er anprangert, so sind doch beide das Symbol eines Bürgerkriegs. Eines Bürgerkrieges, der noch nicht benannt wurde, weil das die Propaganda untersagt.Dennoch ist er real: Die französischen Vorstädte befinden sich in der Gewalt von Jugoslawen oder Libanesen, da hier das Gesetz der Republik von Immigranten und einheimischen Taugenichtsen, die keinerlei Wunsch zur Integration haben, zum Versagen gebracht wird. Wenn Sie bewaffnete Soldatenpatrouillen in der U-Bahn, auf Bahnhöfen, im Hof des Louvre sehen, glauben Sie das sei Disneyland? Nein, sie sind die Konsequenz des islamistischen Terrors und der passiven Anwesenheit der Moslems, die den Islamismus auf hiesigem Boden mehr oder weniger begünstigen.
Nicht anders also als der oben zitierte Peter Weibel hebt Millet in seinem umstrittenen Essay hervor, daß es sich bei dem Attentäter um einen gescheiterten Autor handelt, als Verfasser eines „naiven“ 1,500-seitigen „Paste & Copy“-Kompendiums, dessen Machart ein durch und durch „wikipedisiertes“ Gehirn erkennen läßt. Seine Tat habe eine gewisse „formale Perfektion“ gezeigt, lange vorbereitet und wohl durchdacht in Bezug auf das, was sie mit Blut und Massenmord „kommunizieren“ wollte – durchaus vergleichbar mit der präzise gewählten Symbolik der Ziele des „9/11″-Attentats.
Und wie Weibel sieht auch Millet Breivik als Ausgeburt und Spiegel einer pathologischen Gesellschaft, als „Symptom für die sich abzeichnende Instabilität des Systems“:
Breivik ist in erster Linie ein exemplarisches Produkt der abendländischen Dekadenz im Habitus eines amerikanisierten Kleinbürgers… Er ist nicht nur das Kind der Zerrüttung der Familie, sondern auch des ideologisch-ethnischen Bruchs, den die außereuropäische Einwanderung nach Europa über fünfzig Jahre hinweg verursacht hat, und der lange vorbereitet wurde durch die Einwirkung der amerikanischen Massenunkultur, der ultimativen Konsequenz des Marshallplanes: des Planes einer absoluten Herrschaft des globalisierten Marktes, der Europa enthistorisiert, auf der wirtschaftlichen, kulturellen und ohne Zweifel auch ethnischen Ebene. (…)
Gleich Baudrillard sieht er in dem Terrorakt das grausame Wirken der Nemesis, die sich das System durch seinen eigenen Wahnsinn und seine Maßlosigkeit selbst heraufbeschworen hat:
Breivik ist zweifellos das, was Norwegen verdiente und was unsere Gesellschaften erwartet, die sich unablässig blind stellen, um sich besser selbst verleugnen zu können. (…)
Der Sommer (2011) brachte uns die Nuklearkatastrophe von Fukushima, das Abgleiten der internationalen Politik in die Lächerlichkeit durch die Affäre Strauss-Kahn, dem sozio-priapischen Terroristen und bisher ungewürdigten Gegenstück zu dem christdemokratischen Erotomanen Berlusconi, und, am Morgen nach dem Massaker von Utoya, den Tod von Amy Winehouse, der Breivik beinahe die Schau stahl, vor allem aber den vulkanartigen Ausbruch einer Finanzkrise, die seit dem Jahr 2008 vor sich hinschwelte, und die momentan dabei ist, Europa endgültig in die Knie zu zwingen.
Daß eine Finanzkrise dieses Ausmaßes auch den Bankrott der Zivilisation selbst offenbart, wollen nur die Schwachköpfe nicht sehen. Breivik ist, soviel steht fest, ein verzweifeltes und entmutigendes Symbol für die europäische Unterschätzung der Verheerungen des Multikulturalismus; auch das Symbol einer Niederlage des Geistes vor dem Profit des Geldes. Die finanzielle Krise ist eine Krise des Sinns, der Werte, also auch der Literatur.
Millet verzeichnet in diesem Zusammenhang die seit etwa zwei Jahrzehnten ansteigende Ausbreitung von Massenmorden „amerikanischen“ Stils (sozusagen „à la Columbine“) gerade in jenen (nord-)europäischen Ländern, die lange Zeit als sozial und politisch stabil galten: England, Schweiz, Frankreich, Deutschland und Finnland.
Dabei sieht Millet in Breivik nun durchaus keinen „Warhol des Anti-Multikulturalismus“, der nur auf seine 15 Minuten Ruhm aus gewesen sei und „l‘art pour l‘art“ betrieben hätte:
Weit entfernt, ein Konzeptkünstler zu sein, glaubte Breivik nicht an das, was Baudrillard die „Duplizität“ der zeitgenössischen Kunst nannte, mit ihrem Bekenntnis zur „Nichtigkeit, zur Bedeutungslosigkeit, zum Non-sens, da man ja bereits nichtig ist“ – die in der Tat jeglichen künstlerischen und existenziellen Ansatz zunichte macht. (…)
Er hat auch nicht bloß jene nach Breton einfachste surreale Geste nachvollzogen, die darin bestehe, „wahllos mit dem Revolver in die Menge zu feuern“; er hat auch nicht Cioran beim Wort genommen, der einmal schrieb, daß jeder Mensch, der noch bei Sinnen ist, schon aufgrund der Tatsache, sich auf einer Straße zu befinden, Ausrottungsgelüste bekommen müsse. Beide Sentenzen, sowohl Ciorans und als auch Bretons, wurden bisher viel zu wenig vor dem Untergrund der Kriege und Genozide des 20. Jahrhunderts gelesen, mit Adornos Diktum vom Ende der Kultur „nach Auschwitz“ im Hinterkopf.
Die Ausrottung als literarisches Motiv: das ist das Unrechtfertigbare schlechthin, und dieses beinhaltet die von Breivik indirekt (und gewiß unbeabsichtigt) aufgerollte Frage nach dem Problem der globalen Überbevölkerung und der ökologischen Katastrophe, die sich verkoppelt mit jener nach der demographischen Entvölkerung Europas und der Zerstörung der Homogenität der europäischen Gesellschaften, wie in Norwegen, Finnland, Schweden, Dänemark, Holland, allesamt Länder, in denen jene, die man schamhaft als Populisten bezeichnet, in die Regierungen gewählt wurden. (…)
Millet sieht einen engen Zusammenhang zwischen dem biologischen Tod Europas und dem vorangehenden Tod seiner Seele durch den Materialismus und die Verleugnung und Demontage seiner Identität. Auch im JF-Interview findet er hierfür drastische, harte Worte:
Die Europäer beklagen permanent ihr Schicksal. Spricht man zu ihnen von Zivilisation, antworten sie mit Ökonomie, sozial und ethisch, das heißt mit alltäglichstem Materialismus. Sie sind verfehlte Amerikaner so wie Breivik ein verfehlter Autor ist. Von dem Moment an, wo man sich selbst verleugnet, egal ob Franzose, Deutscher oder Europäer, begibt man sich in eine freiwillige Sklaverei, vollzieht die Unterwerfung der Gegenwart unter die Irrealität. Man selbst zu sein wird eine Art Schändlichkeit.
Würde ist das Empfinden für das, was man denen schuldet, die uns vorausgegangen sind, deren Erbe, die europäische Zivilisation, wir übernommen haben und deren Wurzeln christlich sind. Hat nicht Georges Bernanos gesagt, daß die moderne Zivilisation eine Verschwörung gegen jedwede Art von geistigem Leben ist?
Und er betont den bitteren Preis, den in Frankreich jeder zahlen muß, der es wagt, sich diesem Themenkomplex abseits der vorgeschriebenen Sprachregelungen zu nähern:
Die Gegenwartsliteratur kann sich damit nur unter der Maßgabe der politischen Korrektheit beschäftigen. Zu viele Journalisten fürchten die Justiz, falls sie sich solcher Themen annehmen. Die Darstellung des Ausländers, des Migranten, des illegalen Einwanderers muß explizit stark positiv erfolgen. Sagen Sie etwas anderes, laufen Sie Gefahr, als Faschist, ein anderes Wort für Rassist, beschimpft zu werden, was grotesk ist. Die Zensur hat ihre Form geändert: ständige Selbstzensur und Unterwerfung unter die Welt-Ideologie, post-rassistisch, postmenschlich. Die wenigen Intellektuellen, die es wagen, das Gegenteil zu denken – Alain Finkielkraut, Renaud Camus, Robert Redeker, ich selbst – werden vom größten Teil der Medien gehaßt.
00:03 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : richard millet, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, polémique, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
ELEMENTOS Nº 36. DRIEU LA ROCHELLE. ARTISTA DE LA DECADENCIA
00:05 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : drieu la rochelle, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Renaud Camus parle:
 “Vous avez un peuple et quasiment du jour au lendemain, à l’échelle des peuples, en une génération, vous avez à sa place, sur son territoire, un ou plusieurs autres peuples. Vous avez une culture, une civilisation et en moins de temps qu’il n’en faut à un enfant pour devenir adulte, à un jeune homme pour devenir un homme mûr, se développent sur le même territoire, par substitution, d’autres cultures, d’autres civilisations dont M. Guéant me permettra de dire qu’elles ne valent pas celle qu’elles remplacent, au moins pour prospérer sur ce territoire-là. Poitiers m’en soit témoin, voici que vous avez autour de vous d’autres monuments, d’autres édifices religieux, d’autres visages, d’autre relations entre les hommes et les femmes, d’autres façons de se vêtir, d’autres langues bien souvent et de plus en plus, une autre religion, d’autres nourritures et d’autres rapports à la nourriture, d’autres façons d’habiter la terre et plus encore d’habiter tout court, d’habiter les immeubles, les cages d’escalier, les quartiers, d’autres façons d’administrer l’espace, d’autres rapports à la nature, à l’environnement, à la loi, à la délinquance, à la violence, au contrat social, à la protection sociale, au pacte d’in-nocence, de non-nuisance.
“Vous avez un peuple et quasiment du jour au lendemain, à l’échelle des peuples, en une génération, vous avez à sa place, sur son territoire, un ou plusieurs autres peuples. Vous avez une culture, une civilisation et en moins de temps qu’il n’en faut à un enfant pour devenir adulte, à un jeune homme pour devenir un homme mûr, se développent sur le même territoire, par substitution, d’autres cultures, d’autres civilisations dont M. Guéant me permettra de dire qu’elles ne valent pas celle qu’elles remplacent, au moins pour prospérer sur ce territoire-là. Poitiers m’en soit témoin, voici que vous avez autour de vous d’autres monuments, d’autres édifices religieux, d’autres visages, d’autre relations entre les hommes et les femmes, d’autres façons de se vêtir, d’autres langues bien souvent et de plus en plus, une autre religion, d’autres nourritures et d’autres rapports à la nourriture, d’autres façons d’habiter la terre et plus encore d’habiter tout court, d’habiter les immeubles, les cages d’escalier, les quartiers, d’autres façons d’administrer l’espace, d’autres rapports à la nature, à l’environnement, à la loi, à la délinquance, à la violence, au contrat social, à la protection sociale, au pacte d’in-nocence, de non-nuisance.
J’estime pour ma part, et je commence à n’être pas le seul, que ce changement de peuple, ce Grand Remplacement, est, quoi qu’on puisse en penser d’autre part, qu’on s’en réjouisse ou qu’on le déplore, le phénomène le plus important de l’histoire de France depuis quinze siècles.”
Renaud Camus
00:02 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, europe, affaires européennes, immigration, renaud camus, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


| En librairie le 20 Septembre 2012 | |
| ISBN | 2-36371-0406 |
| Format | 15,5 X 24 CM |
| Pages | 256 p. |
| Prix | 27 € |
Roger Nimier n’est pas mort
Une mort brutale et spectaculaire, en septembre 1962, allait valoir à Roger Nimier une longue postérité de quiproquo. Cet accident biographique aura permis à la mythologie littéraire d’usurper les droits de la littérature, et de faire oublier, tout simplement, un écrivain de premier ordre. Bernard Frank voyait juste quand, dans son célèbre article des Temps modernes, « Grognards et Hussards », il faisait de Roger Nimier un chef de file : même si les Hussards (Roger Nimier, Jacques Laurent, Antoine Blondin) n’ont jamais formé une école, pas même un groupe amical, et n’ont vraiment été réunis que dans l’intention polémique de leurs adversaires, un ton était donné par eux à leur époque, et ce ton - ironie et désinvolture, mais aussi ferveur et panache, Dumas autant que Stendhal - Roger Nimier l’a résumé presque à lui seul.
Trop généreux pour vivre sans amis - sans ennemis aussi - , il a provoqué ses contemporains, qui l’ont aimé ou détesté avec une égale fascination. Bien au-delà de la résistance instinctive à des mots d’ordre passés de mode (l’idéologie de « l’engagement » par exemple), ce qu’on peut appeler « l’esprit hussard » ne faisait que retrouver cette liberté française à la fois hautaine et familière, railleuse et charitable qui, au moins depuis l’Astrée, a formé le climat de notre littérature et quasi son air natal.
Une œuvre de défi
Cinquante ans après la mort de Roger Nimier, il est temps de réévaluer une œuvre et une influence dégagées des douteux prestiges du fait divers - à quoi ce volume voudrait s’employer. Sans oublier l’œuvre parallèle de Jacques Laurent (étudiées comme elle l’aura peu été jusqu’ici par Alain Cresciucci ou Quentin Debray), ni l’amitié d’Antoine Blondin (Jacques Trémolet de Villers fait son portrait en ange déchu), les autres fidèles de Nimier sont présents : Stéphen Hecquet (évoqué par Jean-Denis Bredin) ou Roland Cailleux (Isabelle Cailleux-Desnoyers et Christian Dedet). S’agissant de Nimier lui-même, des études éclairent divers aspects de son œuvre, comme ses rapports avec le cinéma (Philippe d’Hugues) ou démontrent l’évidence de son actualité (Bertrand Lacarelle).
Témoignages et correspondances inédits
Des témoignages d’écrivains, ses aînés (Arland, Céline, Cocteau, Green, Jouhandeau, Léautaud, Morand, Jacques Perret, Jules Roy, Alexandre Vialatte) ses contemporains (Pierre Boutang, Kléber Haedens, Jean-René Huguenin, Éric Ollivier, François Seintein, Willy de Spens) ou ses cadets (José Giovanni, Gabriel Matzneff, Dominique de Roux), mais aussi des éditeurs (Roland Laudenbach, Jean-Claude Fasquelle), un compagnon politique de jeunesse (Robert Poujade) ou un cinéaste qui a œuvré avec lui (Alexandre Astruc), sans compter les souvenirs de lycée de ses condisciples Michel Tournier ou Jean-Jacques Amar. Des correspondances inédites (lettres de l’élève du lycée Pasteur à Jean-Jacques Amar ou du critique de la NRF à Pol Vandromme) ainsi que des articles de jeunesse jamais recueillis complètent cet ensemble dont l’ambition, loin de toute archéologie littéraire et en dehors de tout prétexte anniversaire, est de démontrer par l’exemple ce que doit être la littérature vivante.
Points forts
Actualité : Anniversaire des 50 ans de la mort de Roger Nimier
L’esprit Hussard aujourd’hui : L’incarnation de la liberté française
Valeur : Une œuvre et une influence enfin sorties du « fait divers »
Inédits : Des témoignages inédits et réactualisés ainsi que des articles de jeunesse rares
Dans la presse

François Mauriac avait vu juste «Je suis tranquille quant à votre destin d'écrivain», assurait-il a Roger Nimier dans une lettre d'octobre 1950 « En voila un qui survole Kafka, le surréalisme de tous les cons de cette génération conière!», appuyait-il dans une lettre à son secrétaire Eric Ollivier. Un demi-siècle après une mort brutale - à 36 ans, le 28 septembre 1962 - dans un accident de voiture sur l'autoroute avec l'énigmatique romancière aux airs de walkyriee fifties Sunsiaré de Larcône (alias Suzv Durupt), le chef de file des Hussards Roger Nimier reste une icône de « la droite buissonnière »
Mais pas seulement. Au-delà des invectives du fameux article de Bernard Frank gorgé de pensée sartrienne dans Les Temps modernes de décembre 1952, l'œuvre de Roger Nimier est aujourd'hui fêtée par deux gros volumes riches en études, souvenirs et lettres diverses, des rééditions de ses nouvelles, contes, articles et essais, et deux revues qui saluent son talent de polémiste et de romancier—un numéro hommage de la revue Bordel et une nouvelle- née malicieusement intitulée La Hussarde, nouvelle revue féminine.
Quelle avalanche ! Pour s'y retrouver, signalons la nouyelle totalement inédite « Le clavier de l'Underwood» publiée dans Bal chez le gouverneur, ainsi que les récentes approches critiques et les documents réunis dans Roger Nimier Antoine BlondIN Jacques Laurent et l'esprit hussard Nimier a des amis de tous côtÉs. II est donc temps de retirer les étiquettes collées sur l'auteur des Epées, du Hussard bleu,et des Enfants tristes, qui fut aussi conseiller littéraire chez Gallimard, où il s'occupait de faire vivre l'œuvre du bouillant Céline Paul Morand, bien à droite sur l'échiquier politico-littéraire de l’après-guerre, notait dans son Journal inutile à propos de son petit-fils en littérature «Les Hussards Drôle de penser que Nimier et Jacques Laurent, qui passent pour légers, n'aimaient que la philosophie »
Tête bien faite, bien ordonnée et adepte d'une « respectueuse insolence », Nimier traquait la confusion des esprits et s'élevait contre la littérature engagée A ses côtes, Jacques Laurent avec sa revue La Parisienne, offrait«l'occasion nouvelle de dégager notre bon sens », selon le philosophe Pierre Boutang II n'y eut pas vraiment d’école de Hussards, mais plutôt une proximité temporelle bien venue entre des écrivains qui faisaient vivre l'esprit, ôtaient les cadenas d'une pensée prisonnière, avec méthode humour et désinvolture et sans le sérieux compassé du surréalisme vieillissant, presque notable. Alentour, citons Blondin bien sûr, et Michel Déon, Jacques Perret, Félicien Marceau, Michel Mohrt. Les documents réunis par Massin directeur artistique chez Gallimard et voisin de bureau de Nimier dévoilent son rôle d'éditeur plein de drôlerie à travers ses crayonnages, ses couvertures parodiques, ses prières d insérer écrits sur un coin de table. Nimier qui n’avait pas l'appétit de se connaître trouve, au milieu de l'hommage kaléidoscopique qui lui est rendu, une fraternité et une fidelité heureuses pour une œuvre protéiforme qui dépasse avec succès l'horizon de sa génération.
OLIVIER CARIGUEL
Roger Nimier, Antoine Blondin, Jacques Laurent et l'esprit Hussard, collectif sous la direction de Philippe Barthelet et de Pierre-Guillaume de Roux (Pierre-Guillaume de Roux, 2012)

Cinquante ans après sa mort dans un accident de voiture, de nombreux témoins prennent la plume pour évoquer la figure du "hussard". femmes, romans, alcool, bolides, polémiques avec Sartre ou Camus : derniers secrets de ce prince de l'insolence.
Les fans de Diana ont le 13e pilier du tunnel de l'Alma. Les inconditionnels de Roger Nimier, prince des lettres, ont, eux, une borne sur l'autoroute de l'Ouest, là où le « hussard » de 36 ans perdit la vie dans un terrible accident de voiture, au soir du 28 septembre 1962. C'était il y a très exactement cinquante ans. « Chaque semaine, je passe sur l'autostrade de l'Ouest. On ne réparera jamais, pour moi, certaines bornes, après certain taillis, en arrivant sur le pont de Garches », écrira, mélancolique, son ami Morand. Un demi-siècle après la disparition brutale de notre James Dean de la NRF - cet exact contemporain de Jean d'Ormesson aurait eu 87 ans cette année -, plusieurs ouvrages rassemblant témoignages et textes rares permettent de démêler les légendes qui ont entouré ses mille vies, son oeuvre et sa mort. Flash-back sur ce « jeune premier des lettres à la beauté d'archange buté », comme le croquait François Dufay (i).
Roger Nimier philatéliste.
On l'ignore souvent, mais avant de devenir écrivain l'auteur du Hussard bleu (sans doute son roman le plus « grand public ») a vécu du commerce de timbres. Ayant perdu très jeune son père, ingénieur inventeur de l'horloge parlante, Nimier, qui a grandi dans le XVIIe arrondissement de Paris, entre, à 17 ans, en 1942, dans la maison Miro, près de l'hôtel Drouot Jusqu'à l'aube des années 1950, il y rédigera des notices détaillées. Intéressé au chiffre d'affaires, il dépense tous ses émoluments en livres. « Quand un client en achète pour moins de 10 ooo francs, je lui jette un sale regard. A partir de 100 ooo, je lui dis au revoir. Au-dessus du million, il a droit au sourire », racontera-t-il, avec son insolence coutumière.
Les « poumons de M. Camus ».
Mais c'est évidemment dans ses articles de presse que cette insolence va trouver à s'employer à merveille. Fort du succès d'estime des Epées, cette histoire trouble d'un adolescent passant de la Résistance à la Milice, parue en 1948, Nimier, qui excelle dans la forme courte, est accueilli à bras ouverts par de nombreux journaux. Aux plus beaux jours du Flore, ses formules assassines ne ménagent pas les gloires de Saint-Germain-des- Prés. « Les disciples de Sartre ? Des danseurs », raille-t-il. Les Mandarins, de Simone de Beauvoir ? « Bouvard et Pécuchet existentialistes. » Sans oublier ce titre - un classique, désormais - à la Une de l'hebdomadaire Opéra : « Surprise à Marigny : Jean-Louis Barrault encore plus mauvais que d'habitude ». Scandale. Mais ce n'est rien à côté de celui que va déclencher la terrible charge parue, en février 1949, dans la revue gaulliste Liberté de l'esprit. Evoquant les tensions de la guerre froide, Nimier écrit cette phrase, qu'ils traîne encore comme un boulet : « Et comme nous ne ferons pas la guerre avec les épaules de M. Sartre, ni avec les poumons de M. Camus... » Tollé. Camus était tuberculeux. Les Cahiers de l'Herne exhument aujourd'hui un texte dans lequel Nimier laisse entendre qu'il l'ignorait : « Des circonstances qui nous étaient inconnues ont rendu particulièrement blessant et emphatique un mot qui n'avait pas ces intentions précises. Ceci devrait être dit », s'excuse à mi- mots un Nimier pourtant peu enclin à l'autocritique. Ironie de la vie littéraire, Camus et Nimier auront plus tard tous deux un bureau chez Gallimard et prendront bien soin de s'éviter dans les couloirs de l'auguste maison...
Nimier fasciste ? En 1952, Bernard Frank publie dans Les Temps modernes, la revue de Sartre, Grognards et Hussards, véritable acte de baptême des « Hussards », étiquette sous laquelle il englobe Nimier, Antoine Blondin et Jacques Laurent. Retentissant article, repris intégralement par les Cahiers de l'Herne. Ce qui rapproche ces jeunes écrivains, selon lui ? « Un style au carré, un style qui se voit style» et qui, sur chaque phrase, plante un petit drapeau sur lequel on lit : « J'ai du style. » Mais ce n'est pas tout : ces stylistes seraient avant tout des « fascistes » ! Le mot est lancé. Est-il juste pour Nimier ? Ou Bernard Frank n'était-il qu'un « sartrien de bar » missionné pour discréditer les ennemis de son chef, comme l'écrit Philippe Barthelet, maître d'œuvre de Roger Nimier, Antoine Blondin, Jacques Laurent et l'esprit Hussard, qui paraît ces jours-ci ? Vu de 2012, il faut bien le dire, les positions politiques de Nimier nous paraissent quelque peu confuses : c'est une sorte de gaulliste tendance Maurras, un dandy célinien (c'est lui qui orchestrera, via une retentissante interview dans L'Express, le grand retour du maudit de Meudon, en 1957). Il admire la grandeur du Général - il se mêlera même à la foule qui l'acclame sur les Champs-Elysées en 1958 -, mais, avec son ami royaliste Pierre Boutang, va rendre visite, le 30 mars 1952, au vieux Charles Maurras dans sa résidence forcée, à Tours. « Roger ne sera jamais du côté des vainqueurs, mais toujours des perdants. Il porte en lui le goût de l'échec et l'échec est sa noblesse », avance en guise d'explication Christian Millau, dont Nimier fut le témoin de mariage (2).
Nimier«poseur».Les deux plus célèbres photographies représentant l'auteur des Epées sont des demi-mensonges. La première le montre, regard d'enfant triste et calot sur la tête, en grand uniforme du 2e hussards de Tarbes - elle sera placardée en guise de publicité pour Les Epées sur les camionnettes Gallimard sillonnant Paris. Engagé volontaire à 19 ans, ce qui dénote un certain courage, il intègre ce
Régiment en février 1945.Il rêve de combats sur le Rhin et en Indochine. Il ne dépassera pourtant pas Vic-en-Bigorre, avant d'être rapidement démobilisé. Ses faits d'armes ? A voir lu Pascal en Pléiade à 600 kilomètres du front. Une blessure indélébile qui fera de lui un homme en « permission perpétuelle », selon son biographe Marc Dambre. L'autre cliché « mensonger » relève d'un folklore plus léger : on y voit un Nimier négligemment appuyé sur l'aile d'une superbe Rolls-Royce (voir page précédente'). Il n'en a pourtant jamais possédé ! Robert Massin, alors directeur artistique de Gallimard, révèle aujourd'hui les dessous de cette photo : un beau jour, cette berline était garée devant la maison d'édition, et Nimier a tout simplement posé « en propriétaire » à ses côtés devant son objectif (Massin publie ces jours-ci un petit livre de souvenirs sur « Roger »). Alors, « poseur », Nimier ? C'est ce que lui reprochait affectueusement Mauriac : « Vous ne devez être vraiment "bien" que dans l'amour, c'est-à-dire dompté, maîtrise, vaincu, par une créature devant laquelle vous avez forcément perdu la pose. » Une « pose » - costume croisé, champagne, Jaguar - indissociable du mythe hussard
Ascenseur pour l'échafaud. Si l'on voulait parodier Pierre Desproges se moquant de Duras, on pourrait dire que Roger Nimier n'a pas seulement écrit que des chefs- d'œuvre, il en a aussi filmé. Et parmi ses collaborations plus ou moins heureuses avec le grand écran - il a même mis la main à la pâte du Ali Baba et les quarante voleurs avec Fernandel ! -, un film est resté fiché sur toutes les rétines : Ascenseur pour l'échafaud, de Louis Malle (1958). Il coécrit le scénario avec le réalisateur et rédige les dialogues. Chardonne, l'un de ces écrivains compromis que Nimier contribua à remettre en selle, y voyait le meilleur de son œuvre. La mélancolie de Maurice Ronet, la Mercedes 300 SL en trombe sur l'autoroute, la tristesse de Jeanne Moreau-Ascenseur pour l'échafaud, c'est du pur Nimier. Au passage, l'écrivain aura une liaison avec la comédienne. Un soir tard, où Gaston Gallimard entre dans le bureau de Nimier, il tombe par hasard sur le « couple » : « Oh ! pardon, monsieur Nimier, j'ai vu de la lumière dans votre bureau et j'ai pensé que vous aviez oublié de l'éteindre », s'excuse Gaston, avant de s'éclipser. « Le concierge ? » demande Moreau.«Le patron», répond Nimier.
L'accident. Gaston et Roger, tous deux amoureux de belles voitures, s'étaient connus un beau jour de 1948 où, venu lui proposer le manuscrit des Epées, le jeune romancier avait déclaré : « Je viens, monsieur, pour changer de l'encre en essence. » Et quand, avec ses émoluments de chez Gallimard, Nimier pourra s'offrir une Aston Martin rouge, il la surnommera facétieusement la « Gaston Martin ». On le verra aussi au volant d'une élégante Jaguar décapotable ou d'une Delahaye. Son goût de la vitesse le perdra. Le 28 septembre 1962, alors que, après un silence romanesque de dix ans, Nimier vient de remettre le manuscrit de son D'Artagnan amoureux, il voit Antoine Blondin et Louis Malle au bar du Pont-Royal pour évoquer une adaptation de Feu follet. Il retrouve ensuite Sunsiaré de Larcône, une ravissante romancière à la longue chevelure blonde. Ils passent à la rédaction d'Elle, boivent quelques verres à un cocktail et prennent finalement l'autoroute de l'Ouest dans la fameuse Aston Martin. Quelques minutes plus tard, c'est l'accident, violent, à pleine vitesse. Les deux occupants sont tués. Que sait-on de nouveau sur ce drame cinquante ans après ? Christian Millau rappelle que son ami Roger « avait 2,8 grammes d'alcool dans le sang, ce qui faisait une mort passablement ordinaire ». Une rumeur assure pourtant que c'était en fait Sunsiaré de Larcône qui était au volant. Massin le confirme : « On le tint secret longtemps à cause de l'assurance. » Certains ajoutent même que la jeune femme avait coutume de conduire pieds nus. Comme si, jusqu'en la mort, la légende devait toujours magnifier la réalité. Trois ans auparavant, avec son sens très sûr des catastrophes, Louis-Ferdinand Céline avait pourtant prévenu son ami Roger au détour d'une lettre : « Ne vous faites pas blesser, accidenter !... L'accident est un sport de riches »...
JEROME DUPUIS
Roger Nimier, Antoine Blondin, Jacques Laurent et l'esprit Hussard, collectif sous la direction de Philippe Barthelet et Pierre-Guillaume de Roux (Pierre-Guillaume de Roux, 2012)

Il y a cinquante ans, l'auteur Il y a cinquante ans, l'auteur des « Enfants tristes » disparaissait au volant de son Aston Martin. Depuis, sa légende a suscité de nombreux malentendus. Retour sur un parcours mené à 200 km/h.
Vivant, Roger Nimier aurait juste 87 ans. Il serait plus jeune que Sté- phane Hessel et afficherait le même âge que Jean d'Ormesson. Il semble pourtant d'un autre temps, d'un autre monde. Sa mort sur la route de ses 37 ans l'a momifié. Il n'aimait pas les photos. Nous n'aimons pas le voir, le front ceint d'un linceul, couché comme un gisant, à l'hôpital de Garches, tout comme cette jeune femme, dans le même état, également finie, immaculée. C’était la nuit du 28 septembre 1962 sur l'autoroute de l'Ouest, l'Aston Martin de Nimier emmenait aussi une superbe fille de 27 ans, blonde comme la Beauce en été. Sous le pseudonyme de Sunsiaré de Larcône, elle venait de lancer son premier roman, La Messagère. Le bolide a percuté sept bornes en béton avant de s'aplatir contre le parapet d'un pont près de Paris. La fille conduisait-elle ? En octobre, après neuf ans de silence livresque, sortirait un roman posthume de Roger, ce D'Artagnan amoureux qui s'exclamait : «Il n'y a que les routes pour calmer la vie. » Le mythe naissait dans ce qui avait baigné sa vie et son œuvre : l'énergie, l'ironie, l'inquiétude.
Dès le départ, il a foncé. En1948, après le refus par Gallimard de poèmes, d'un récit et d'un roman (L'Etrangère), il publie Les Epées. En 1950, deux romans, Perfide et Le Hussard bleu, et un essai, Le Grand d'Espagne. En 1951, Les Enfants tristes. Il écrit en Jaguar, il faut le freiner. L'essai Amour & Néant attendra 1953 pour sortir. Qu'est-ce qui faisait tant remuer ce fils de la bourgeoisie bretonne et picarde élevé dans les beaux quartiers parisiens et nourri de lectures énormes ? Un double drame, peut-être. La mort d'un père en 1939 précède de peu la débâcle du pays. Fin 1944, il veut s'engager dans l'aviation, or le ciel est bouché, plus de place. En mal d'Histoire, il rejoint le 2e hussards à Tarbes en mars 1945, mais c'est trop tard pour la légende et le casse-pipe. Voulant se battre, il n'aura fait que lire. Il va attaquer la paix en écrivant «Nous sommes les vivants», prévient-il dans Le Grand d'Espagne. « Les lumières de Juin 1940 et de l'été l944 se confondent à présent, le désespoir et la chance font une égale balance : nous rejetons cet équilibre honteux. Vichy, le gaullisme, la collaboration sont rendus à l'Histoire. » Il espère une « nouvelle civilisation», un «renversement des valeurs» Deuil et renaissance. « Un pas encore et nous serons les maîtres. «C’est la déclaration de guerre des vingt ans en 1945. Cette génération, il faudra la réduire. En 1952, Bernard Frank, écrivain et critique en herbe, s'y emploie dans la revue Les Temps modernes, avec un sens de la mesure toute sartrienne : «Nimier est de loin le favori d'un groupe de jeunes écrivains que, par commodité, je nommerais fascistes » et dont les «prototypes » sont Antoine Blondin et Jacques Laurent. Frank persévère et ce n'est pas triste : « Comme tous les fascistes, les hussards détestent la discussion. Ils se délectent de la phrase courte, dont ils se croient les inventeurs. Ils la manient comme s'il s'agissait d'un couperet. A chaque phrase. Il y a mort d'homme. Ce n'est pas grave. C'est une mort pour rire.«Fasciste... Pauvre France, pauvre Frank. Il confond l'auteur et son personnage, Nimier et le François Sanders des Epées et du Hussard bleu qui disait : « Quand les habitants de la planète seront un peu plus difficiles, je me ferai naturaliser humain. En attendant je préfère rester fasciste, bien que ce soit baroque et fatigant. » Nimier était trop difficile pour être fasciste. Et trop profond pour la hussardise. Il traîne encore ce pénible label à l'épicerie de la critique littéraire. De plus en plus délavée, collée à droite, l'étiquette hussard a d'abord désigné une postérité émue et fraternelle avant de solder un quarteron de gribouilles éthyliques.
Dans l'ouvrage qu'ils dirigent, Roger Nimier, Antoine Blondin, Jacques Laurent et l'esprit hussard, Philippe Barthelet et Pierre-Guillaume de Roux veulent exfiltrer Nimier du «folklore imbécile» des hussards. Le premier procède bizarrement en minorant ses romans, des « œuvres de jeunesse », au profit de ses articles. Les romans n'ont pas d'âge. Et la jeunesse a sa sagesse, son passé. Le Hussard bleu est dédié au copain d'enfance Stièvenard, mort en Allemagne en 1945, Les Enfants tristes, à l'ami juif Mosseri, fusillé par les « Schleus ». Les romans de Nimier sont les tombeaux d'un surdoué, d'un Rimbaud qui aurait assimilé Retz et Peter Cheyney. Dans le beau Cahier de l'Herne consacré à Nimier et dirigé par Marc Dambre, Philippe Berthier remet les pendules à l'heure en plaçant le jeune romancier dans le sillage de Stendhal, Balzac et Dumas.
Avant-gardiste et mondialiste à ses heures, il lit Joyce et Faulkner Frank n'était pas léger en tout. Il a bien vu la dimension « pour rire » de Nimier. Rire pour dissoudre la lourdeur des temps, rire d'être « écorché».Mais ce n'était qu'une facette d'un écrivain trop profond pour ignorer les accointances de l'humour avec la mort. Après Histoire d'un amour, en1953, il lève le pied, stoppe les romans. C'est la tentation d'un certain silence, finement filée par la biographie de Dambre (Roger Nimier. Hussard du demi-siècle, Flammarion, 1989), qui mériterait d'être rééditée en poche. Nimier prend congé de la psychologie et du moi romanesques. Il s'expose pour se cacher, envoie son double dans les alcôves de Paris, prend le virage des journaux. Après la rédaction en chef de l'hebdomadaire Opéra, il critique à Carrefour, orchestre le Nouveau Femina, chronique dans Arts et au Bulletin de Paris. Des articles qui sont souvent de courts essais étincelants d'esprit et de pénétration. Réac franchouillard, Nimier ? Plutôt d'avant-garde et mondialiste à ses heures, fervent lecteur de Faulkner, Joyce, Ponge, Kafka, Borges...
Des auteurs qu'on retrouvera plus tard à la une de Tel Quel, la bible maoïste de Philippe Sollers. Cela ne l'empêche pas de lancer le livre de Poche Classique. Entré comme conseiller littéraire chez Gallimard fin 1956, il monte au créneau pour «Un château l'autre, de Céline, et remue ciel et terre pour lui, qui a eu comme Saint-Simon « l'invention géniale de ne pas inventer et l'imagination terrible de regarder». Le romancier Céline incarne une forme spéciale de nouveauté, jaillie de l'œuf du classicisme. A sa manière, il fait des enfants dans le dos de la tradition. De quoi plaire à Nimier, qui s'ennuie presque partout «Dans la vie, je ne vois rien du tout, sinon la sottise de mon existence, passant d'un bureau à une nursery, accablé de travail, de cris d'enfants, tout cela sans espoir ni distractions, sinon notre déjeuner l'autre jour », écrit-il à Jacques Chardonne, en juillet 1958. Marié depuis 1954, il a un fils, Martin, et une fille, Marie, qui sera écrivain. Marie Nimier est l'auteur d'un récit sur ce père mort quand elle avait 5 ans. La Reine du silence fourmille de scènes rapportées ou qu'elle a un peu vécues.
Un jour, Nimier a pointé un pistolet sur la tempe du petit Martin clans son berceau. Pour rire, évidemment. Beaucoup plus tard, devenue mère, Marie a retrouvé un mot paternel datant de l'été 1957 : «Au fait, Nadine a eu une fille hier. Jai été immédiatement la noyer dans la Seine pour ne plus en entendre parler. »Pour rire, encore. Nimier n'était pas facile à vivre en famille ou en société. Il buvait sec. Ses blagues rempliraient un volume de l'Almanach Vermot, elles avaient souvent un goût saumâtre, macabre. Il ne s'amusait bien qu'entre hommes aventureux. Pointer au hasard son doigt sur la ville d'une carte de France, et s'y rendre illico en bagnole, sinon ce n'est pas du jeu. Ou aller chercher en livrée de chauffeur et voiture de maître l'ami Blondin retenu en cellule de dégrisement au commissariat. Une scène de comédie pour celui que le cinéma a beaucoup diverti. Dans le rôle du scénariste, Nimier a travaillé pour Antonioni (I Vinti), Malle (Ascenseur pour l'échafaud), Siodmak (L'Affaire Nina B.), Becker, Astruc. «Devant un film, on est seul. La nuit étouffe les visages. (...) Il y a une âme collective au théâtre, c'est celle qui permet le Mystère. Elle est inutile au cinéma, puisqu'il présente le déroulement du rêve. » Qui atteint cette altitude à 24 ans ? A 31 ans, il affrontait des trous d'air : « Laissez-moi vivreen dehors de ce milieu, élevé dans le cuite de Gallimard, des Lazareff, des Jaguar, de Martine Carol et du marxisme - toutes choses que je connais mieux qu'eux», confiait-il à Chardonne. Nimier n'est jamais sorti de ce milieu. Il filait rendez-vous à Jeanne Moreau dans son bureau chez Gallimard.
Nimier, il faut le lire à 20 ans, comme Olivier Frébourg dans son Roger Nimier. Trafiquant d'insolence (« La Petite Vermillon », La Table Ronde, 2007), et le relire vingt ou trente ans plus tard, pour le réévaluer face aux malentendus, aux diffamations posthumes, aux feux falots, aux cossards bleus. « Trop d'alcool, trop de sang, trop de XXe siècle dans le sang, trop de mépris », avouait Sanders dans Le Hussard bleu. Mais Nimier, c'était autre chose, quelqu'un d'autre. Trop de littérature dans le sang, trop d'amour du Grand Siècle, trop d'espoir dans un siècle si petit. Il faut lui rendre sa liberté.
JEAN-MARC PARISIS
Roger Nimier, Antoine Blondin et Jacques Laurent et l'esprit Hussard, collectif sous la direction de Philippe Barthelet et Pierre-Guillaume de Roux (Pierre-Guillaume de Roux, 2012)
00:05 Publié dans Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, roger nimier |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le Bulletin célinien, n° 346, novembre 2012
Le Bloc-notes de Marc Laudelout
 Pendant des années, l’iconographie a été le parent pauvre de la bibliographie célinienne. D’autant qu’elle fut souvent réduite à des formats ne mettant guère en valeur ni les portraits, ni les lieux, ni les manuscrits présentés ¹. C’est seulement depuis peu que sont édités des ouvrages d’envergure pour le plaisir des amateurs de documents photographiques. On songe aux deux albums procurés par David Alliot : Céline à Meudon. Images intimes, 1951-1961 (Ramsay, 2006) et, en collaboration avec François Marchetti, Céline au Danemark, 1945-1951 (Le Rocher, 2008). Pour le cinquantenaire de la mort de l’écrivain, nous eûmes droit à une belle édition des photographies de Pierre Duverger : Céline. Derniers clichés (Imec-Écriture). Et, deux ans auparavant, au coffret Un autre Céline, composé de deux volumes [De la fureur à la féerie & Deux cahiers de prison] dû à Henri Godard (Textuel). Sans oublier les hors-série de magazines édités à l’occasion du cinquantenaire (Le Figaro-Magazine, Télérama, Lire, Le Magazine littéraire).
Pendant des années, l’iconographie a été le parent pauvre de la bibliographie célinienne. D’autant qu’elle fut souvent réduite à des formats ne mettant guère en valeur ni les portraits, ni les lieux, ni les manuscrits présentés ¹. C’est seulement depuis peu que sont édités des ouvrages d’envergure pour le plaisir des amateurs de documents photographiques. On songe aux deux albums procurés par David Alliot : Céline à Meudon. Images intimes, 1951-1961 (Ramsay, 2006) et, en collaboration avec François Marchetti, Céline au Danemark, 1945-1951 (Le Rocher, 2008). Pour le cinquantenaire de la mort de l’écrivain, nous eûmes droit à une belle édition des photographies de Pierre Duverger : Céline. Derniers clichés (Imec-Écriture). Et, deux ans auparavant, au coffret Un autre Céline, composé de deux volumes [De la fureur à la féerie & Deux cahiers de prison] dû à Henri Godard (Textuel). Sans oublier les hors-série de magazines édités à l’occasion du cinquantenaire (Le Figaro-Magazine, Télérama, Lire, Le Magazine littéraire).
Vient de paraître Le Paris de Céline par Patrick Buisson, tiré de son film éponyme ². Composé de quatre parties, cet album donne à voir les lieux en s’efforçant de restituer l’ambiance dans laquelle l’écrivain évolua, de son enfance (le passage Choiseul) à ses dernières années (Meudon) en passant par sa vie de médecin et d’écrivain dans deux arrondissements populaires de la capitale (Clichy et Montmartre). C’est en historien, et pas seulement en lettré, que Patrick Buisson retrace l’itinéraire parisien du Docteur Destouches. Ainsi, rappelle-t-il qu’en 1925, la liste communiste de Clichy remporta la majorité absolue au conseil municipal. C’est là que le docteur Destouches allait, peu de temps après, ouvrir son premier cabinet médical. L’ouvrage reproduit des photographies de l’époque mais aussi des extraits choisis de l’œuvre. La manière dont celle-ci s’est intimement nourrie de l’expérience vécue de l’écrivain est ainsi illustrée par l’image et par le texte de Céline lui-même, à l’instar de ce que proposa le film. Les pages évoquant le passage Choiseul, l’école communale, l’Exposition universelle de 1900, – qui ont inspiré des pages mémorables de Mort à crédit – constituent à cet égard une vraie réussite. Le format in-quarto y contribue autant que la reproduction pleine page de nombreuses photographies. Connues pour la plupart, elles ont rarement aussi bien été mises en valeur. Seuls les puristes feront observer que ce n’est pas Elizabeth Craig qui figure sur certains clichés erronément légendés, et que c’est Cillie Pam (et non Albert Harlingue) l’auteur de ce beau profil de Céline immortalisé au début des années trente. Les esprits chagrins, eux, s’étonneront du ton enlevé de certains commentaires. C’est ne pas voir qu’ils se veulent – tâche redoutable, il est vrai – au diapason de la fameuse émotion du langage parlé restituée dans l’œuvre.
De son exil danois, Céline contemplait avec émotion des cartes postales de Clichy qu’un ami lui avait adressées. Nul doute qu’il aurait été captivé par celles figurant dans cet album.
Marc LAUDELOUT
1. Dans l’ordre chronologique : l’Album Céline de La Pléiade (1977), suivi du Catalogue de l’exposition Céline à Lausanne ; 30 photographies dans la collection « Portraits d’auteurs » des éditions Marval (1997) ; la série de cartes postales (« Lieux, portraits et manuscrits ») procurée par le Lérot (1992-1994) et la monographie de Pascal Fouché dans la collection « Découvertes » de Gallimard (2001). Seule exception quant au format : le livre d’Isabelle Chantermerle, Céline, publié par Henri Veyrier (1987) qui reproduit quelques documents d’intérêt inégal. Et, dans un format intermédiaire, le Paris Céline de Laurent Simon, malheureusement épuisé, qui vaut autant pour les photos que pour le texte ; il demeure l’ouvrage plus complet sur le sujet (Du Lérot, 2007).
2. Patrick Buisson, Le Paris de Céline, Albin Michel-Histoire, 192 pages, plus de 275 illustrations.
00:04 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marc laudelout, céline, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Conferenza su Louis-Ferdinand Céline
di Andrea Lombardi
Fiera del libro di Milano, 2012
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


| En librairie le 18 Octobre 2012 | |
| ISBN | 2-36371-0413 |
| Format | 125 x 195 mm |
| Pages | 286 p. |
| Prix | 23 € |
LES ESSAIS
Philippe Muray (1945-2006), partout cité sur Internet, court, désormais, le grand risque d'être réduit à une caricature de pamphlétaire ou comique Bobo. D’où l’urgence de rétablir la vérité à son sujet : loin de se revendiquer comme critique, Muray s’est, au contraire, essayé au roman. Parce que seul le roman se saisit de la réalité vivante. Problème : le monde avait changé, la « réalité » même n’était plus qu’une fiction. Usant de divers registres, armé de connaissances jusqu'au cou, il avoue multiplier les angles de vue pour tenter de circonscrire la véritable nature de notre monde : un monde bien loin de Balzac, avec ses agents d'ambiance, ses techniciennes de surface, son obsession de la fête et surtout du Bien. C'est l'histoire du "roman" murayien que raconte Lire Muray à l'aune de son expérience picturale (La Gloire de Rubens), de sa saisie de l'Histoire entre Hegel et Braudel (Le dix-neuvième siècle à travers les âges), de son rejet de la "comédie" du monde partagée avec Céline, Baudelaire et Balzac, sans oublier sa fascination pour le phénomène d' « indifférenciation » née de la désacralisation (Entretiens avec René Girard) qui dissimule une violence sans précédent. La place de Muray dans le "débat" ou plutôt le "non débat intellectuel", l'aspect très particulier de son esprit satirique, toujours épris d'authenticité, sans oublier un glossaire de ses "concepts" phares achèveront d'éclairer le lecteur sur le "code" d'interprétation à donner à son langage et à son discours.
LES AUTEURS
Alain Cresciucci : Professeur émérite à l’université de Rouen, ses recherches portent sur le roman et les romanciers français contemporains : Antoine Blondin (Gallimard) ou Les désenchantés (Fayard)
François-Emmanuel Boucher : est directeur du Département d'études françaises du Collège militaire royal du Canada et doyen associé de la Division des études supérieures et de la recherche. Cofondateur du groupe Prospéro sur « Le politique du roman contemporain », il est l’auteur d’un ouvrage sur la rhétorique révolutionnaire et réactionnaire au tournant du XVIIIe siècle : Les révélations humaines.
Jérôme Couillerot : Doctorant en philosophie du droit à Paris II-Assas (Institut Michel Villey).
Laurent de Sutter : FWO Senior Researcher en théorie du droit à la Vrije Universiteit Brussel. Enseignant aux Facultés Universitaires Saint-Louis. Auteur de (Pornostars – Fragments d’une métaphysique du X ; De l’indifférence à la politique, PUF ; Deleuze – La pratique du droit, il dirige la collection « Travaux Pratiques » aux P. U. F.
Guillaume Gros : Historien (Framespa-Grhi, Toulouse 2) est l’auteur d’une biographie de Philippe Ariès (Presses Universitaires du Septentrion, 2008) et d’un essai sur François Mauriac (Geste éditions, 2011).
Hubert Heckmann : Ancien élève de l’ENS Ulm, il est maître de conférences à l’Université de Rouen
Alain-Jean Léonce : travaille dans le commerce équitable. Il prépare un essai sur Muray.
Isabelle Ligier-Degauque : Maître de conférences en arts du spectacle à l’Université de Nantes, elle a publié Les Tragédies de Voltaire au miroir de leurs parodies dramatiques : d’Œdipe à Tancrède, (Champion, 2007).
LES POINTS FORTS
-Toute la vérité sur la « fausse » image de Philippe Muray, devenu auteur mondain malgré lui.
-A la recherche des sources d’inspiration cachées du grand « contemporain ».
-La naissance d’un genre romanesque hybride, tourné vers le monstrueux d’une société fictive.
00:05 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; lettres, lettres françaises, littérature française, philippe muray |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Hojjat al-Haqq Khâdjeh Imâm Ghiyâth ad-Din Abdoul Fath Omar Ibn Ibrâhim al-Khayyâm Neyshâbouri, plus connu sous son pseudonyme Khayyâm, naquit à Neyshâbour, ville située au nord-est de l’Iran actuel. On ignore la date précise de sa naissance mais la plupart des chercheurs penchent pour 1048. Il est néanmoins certain qu’il vécut de la première moitié du XIe siècle à la première moitié du XIIe siècle. Les historiens sont unanimes pour le savoir contemporain du roi seldjoukide Djalâl ad-Din et de son fils Soltân Sandjar. Savant remarquable de son époque, il choisit le pseudonyme de « Khayyâm » (qui signifie « fabricant de tente ») en référence au métier de son père qu’il n’a probablement pas exercé lui-même, contrairement à Attâr (droguiste) qui pratiquait lui-même le métier dont il porte le nom.

Enfant et adolescent, Omar Khayyâm étudia sous la direction des grands maîtres de son époque tels qu’Emâm Mowaffagh Neyshâbouri, considéré comme le meilleur professeur du Khorâssân. La légende, fausse, veut que Abou Hassan Nezâm-ol-Molk, le célèbre vizir, et Hassan Sabbâh aient partagé l’enseignement de ce maître. Et ces trois hommes auraient convenu que celui des trois qui atteindrait le premier la gloire ou la fortune y introduirait également les deux autres.
Khayyâm étudia aussi la philosophie avec Mohammad Mansouri. C’est ce maître qui initia Khayyâm à l’œuvre et à la pensée avicenniennes, qu’il apprécia et continua d’étudier jusqu’à la fin de sa vie.
Il vécut plus tard à Samarkand où il écrivit deux traités. Il y écrivit aussi, avec l’appui d’Abou Tâher Abd al-Rahmân Ahmad, le juge suprême de Samarkand, son livre très important intitulé Risâla fi Barâhin alâ Masâ’il al-Jabr wa al-Moghâbila (Traité des démonstrations de problèmes d’algèbre). Il alla ensuite à Balkh, important centre scientifique de l’époque, pour y approfondir ses connaissances et bénéficier des grandes bibliothèques de cette ville.
A son retour à Neyshâbour, il était déjà reconnu en tant que savant. Le roi Malek Shâh l’invita à ce titre à faire partie de l’équipe chargée de la réforme du calendrier solaire. Il accepta et participa lors de ce projet, à la construction d’un observatoire à Ispahan. Il travailla aussi pendant quelques temps comme astrologue à la cour, sans pour autant croire à l’astrologie. Il travailla plusieurs années sur son ouvrage mathématique Risâla fi sharh iskhâl mâ min Mosâdirât Kitâb Oqlidos (Traité sur quelques difficultés des définitions d’Euclide). Après les morts de Malek Shâh et de son vizir Nezâm-ol-Molk, Khayyâm perdit ses mécènes et l’Etat arrêta de subvenir aux frais de l’observatoire de Khayyâm, qui mourut quelques temps plus tard à Neyshâbour.
Son tombeau se trouve au sud-est de Neyshâbour, près des tombeaux d’Attâr et de Kamâl al-Molk. On ne connaît pas la date exacte de la construction de son premier tombeau, qui fut de nombreuses fois changé au cours des siècles. Son tombeau actuel a été construit en 1962.
De son vivant, Khayyâm était surtout connu comme mathématicien, astronome et philosophe. Ses études sur les équations cubiques sont remarquables et représentaient une découverte importante dans le domaine de mathématiques. Il traite ce sujet dans son traité le plus connu Risâla fi Barâhin alâ Masâ’il al-Jabr wa al-Moghâbila (Traité des démonstrations de problèmes d’algèbre). Il fut le premier mathématicien à déclarer qu’il était impossible de tracer des équations cubiques par le seul moyen des mesures et des boussoles et il se servit lui-même des tracés de coniques pour les résoudre. Il découvrit d’ailleurs que les équations cubiques ont plus d’une racine réelle. Il étudia également et commenta les œuvres d’Euclide et écrivit un traité sur quelques-unes de ses définitions.
Auteur d’études sur les nombres, il définit les nombres comme une quantité continue et présenta alors pour la première fois une définition des nombres réels positifs. Il signala aussi que du point de vue mathématiques, on pouvait diviser toute quantité en parties infinies.
Dans son ouvrage intitulé L’Histoire des mathématiques, Carl B. Boyer considère Khayyâm comme l’un des plus grands précurseurs de l’algèbre dans la période qui suit les mathématiques grecques et indiennes. Selon lui, Khayyâm connaissait le triangle connu aujourd’hui sous le nom de Pascal, bien avant celui-ci. Ernest Renan considérait aussi Khayyâm comme un érudit de mathématiques.
Khayyâm composa également Zidj-e Mâlekshâhi (Les tables astronomiques) et participa à la réforme du calendrier persan, à la demande du roi seldjoukide Malek Shâh. Khayyâm introduisit l’année bissextile et mesura la longueur de l’année comme étant de 365,24219858156 jours. L’année djalâli, ainsi réformée, est plus exacte que l’année grégorienne qu’on créa cinq siècles plus tard. ہ la fin du XIXe siècle, on calcula la longueur de l’année comme étant de 365,242196 jours et ce n’est qu’aujourd’hui qu’on tient la longueur de l’an de 365,242190 jours. Le calendrier solaire dont on se sert actuellement en Iran doit donc son exactitude à ce grand savant.
Khayyâm, considéré de son vivant comme savant, est aujourd’hui célèbre pour ses poèmes. Peu de ses contemporains connaissaient ses quatrains et rares sont les historiens de l’époque qui le citent dans les anthologies de poètes. Le premier à le faire fut Emâdeddin Kâteb Esfahâni, dans son anthologie Farid al-Ghasr en 1193, soit presque une cinquantaine d’années après la mort de Khayyâm.
Khayyâm a exprimé ses sentiments et ses idées philosophiques dans de beaux et courts poèmes épigrammatiques appelés Robâiyât ; au singulier robâi, qu’on pourrait traduire en français, faute de terme propre, par le mot « quatrain ». Le robâi est composé de quatre vers, construits sur un rythme unique, le premier, le second et le quatrième rimant ensemble, le troisième étant un vers blanc. Le premier poète iranien connu pour ses robâi est Roudaki, mais ceux de Khayyâm occupent une place à part.
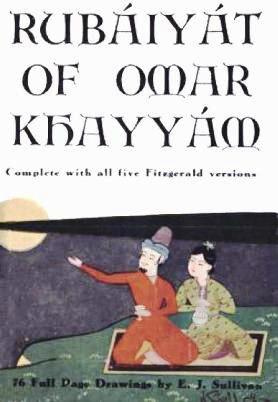
Le plus ancien exemplaire manuscrit des Robâiyât, actuellement conservé à Oxford, date de 1477. Il comprend cent cinquante-huit quatrains attribués à Khayyâm et rassemblés trois siècles après sa mort. Il existe tant d’exemplaires manuscrits de cette œuvre qu’il est aujourd’hui très difficile de savoir lesquels de ces quatrains sont vraiment de Khayyâm. D’ailleurs, le nombre des robâiyât varie d’un exemplaire à l’autre. Dans les manuscrits les plus anciens, les quatrains attribués à Khayyâm vont de 250 à 300. Mais plus on s’approche de l’époque actuelle, plus le nombre des quatrains attribué à Khayyâm tend à augmenter. La plupart des chercheurs attestent uniquement l’authenticité d’une centaine de ces quatrains. En 1934, Sâdegh Hedâyat prépara une édition comprenant les quatrains 56 et 78 à 143. Quelques années plus tard, les chercheurs littéraires Foroughi et Ghani publièrent une édition corrigée de 178 des quatrains. Parmi les autres recherches faites à ce propos, celle du danois Arthur Christensen est également remarquable. Celui-ci est l’auteur de deux ouvrages à ce propos : Les recherches sur les Ruba’iyat d’Omar Khayyâm, écrites en français et publiées en 1905 à Heydenberg, et Etudes critiques sur les Ruba’iyat d’Omar Khayyâm Khayyâm, en anglais, qui furent publiées à Copenhague en 1927.
Khayyâm est aujourd’hui mondialement connu pour ses Robâiyât, traduits dans la plupart des langues du monde.
En Occident, le premier à l’avoir fait découvrir est l’Anglais Thomas Hide qui, dans son livre L’Histoire de la religion des Perses, des Parthes et des anciens Mèdes, traduisit en latin certains quatrains de Khayyâm et les publia à Oxford.
Au début du XVIIIe siècle, l’ambassadeur britannique à la cour de Fath Ali Shâh Qâdjâr publia une première traduction anglaise de certains quatrains de Khayyâm. En 1818, Joseph von Hammer Purgstall, l’orientaliste autrichien, dans son livre L’Histoire littéraire des Iraniens traduisit des passages de Khayyâm en allemand.
Cependant celui qui ouvrit le chemin de la célébrité de Khayyâm en Europe fut l’un des directeurs de l’école sanscrite de Calcutta qui fit connaître Khayyâm et ses idées à son élève Fitzgerald, à qui les Robâiyât doivent leur célébrité mondiale.
Ce fut la traduction anglaise d’Edward Fitzgerald qui fit connaître au grand public, en 1859, l’œuvre poétique de Khayyâm et qui servit de référence aux traductions dans beaucoup d’autres langues. Cette traduction, d’abord peu connue, obtint quelques années plus tard un grand succès. Cette traduction souleva cependant de nombreuses discussions : ce livre était-il une vraie traduction ou son auteur mystérieux voulait dissimuler sa vraie identité en se présentant comme un simple traducteur ? Les éditions suivantes rendirent les quatrains célèbres dans le monde entier, et les Robâiyât devinrent le livre le plus vendu après la Bible et les pièces de Shakespeare. Entre les années 1895 et 1929, quatre cent dix éditions de ce livre ont paru en anglais et plus de sept cents livres, articles, compositions théâtrales et musicales s’en sont inspirés. Les francophones ont également fait de nombreuses recherches sur Khayyâm et ses œuvres qui seront abordées dans un autre article de ce dossier. Durant la seconde moitié du XIXe et tout au long du XXe siècle, plusieurs traductions des Robâiyât furent publiées dans différentes langues. Il faut signaler que ce n’était pas seulement cet ouvrage qui attirait l’attention des étrangers, mais également le travail et les traités scientifiques de Khayyâm. Les œuvres de Khayyâm, en particulier ses Robâiyât, inspirèrent de nombreux écrivains, poètes et artistes dont Marguerite Yourcenar, Amin Maalouf, Granville Bantock, Jean Cras, Ernest Renan ou Jose Louis Lopez.
Les célèbres Robâiyât de Khayyâm ont fait l’objet d’un très grand nombre de traductions en différentes langues occidentales. Si la première et la plus fameuse fut la traduction anglaise de Fitzgerald, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, plusieurs traductions françaises des Quatrains ne tardèrent pas à être publiées. Les fameux poèmes suscitèrent de nombreux débats concernant la personnalité de leur auteur : Khayyâm était-il un hédoniste ou même un ivrogne aux penchants nihilistes avide de profiter des jouissances de l’instant présent ? Ou était-il plutôt un grand mystique ayant exprimé les mystères de l’existence au travers d’un langage très chargé symboliquement, mais n’en révélant pas moins une intense profondeur spirituelle ? Entre ces deux visions du personnage, des dizaines d’autres « Khayyâm » ont été évoqués et parfois argumentés au cours d’âpres échanges par articles interposés. Si l’ensemble de ces controverses ne nous apporte peut être pas beaucoup d’éclairage sur qui fut réellement Khayyâm, elle a néanmoins l’intérêt de nous révéler certains aspects de la mentalité et de la vision du monde de plusieurs grands écrivains du XIXe et du XXe siècles.

La première traduction anglaise des Robâiyât de Khayyâm, réalisée en 1859 par Fitzgerald, passa au départ presque inaperçue. Ce dernier y présentait Khayyâm comme un penseur et philosophe profond, mais n’en étant pas moins habité par de profondes souffrances métaphysiques qu’il ne pouvait consoler qu’en se réfugiant dans des plaisirs terrestres comme les femmes ou le vin. Selon Fitzgeral, loin d’être métaphorique, le langage de Khayyâm décrit donc ses souffrances et ses quelques refuges dans ce monde. Une première traduction française réalisée par Nicolas – de bien moins bonne qualité que celle de Fitzgerald – fut publiée quelques années après en 1867. Nicolas avait été consul plusieurs années dans la ville iranienne de Rasht et y avait appris le persan. Il avait également fréquenté plusieurs dervishes qui l’avaient orienté vers une interprétation gnostique des quatrains : loin de faire référence au vulgaire jus de raisin, le vin ou les femmes évoqués par Khayyâm ne pouvaient être compris que dans le cadre d’un riche symbolisme exprimant la quête mystique d’un Khayyâm en constante recherche d’élévation et de spiritualité. Va ici commencer une controverse entre les deux traducteurs et qui oppose une lecture littéralise et « terrestre » des quatrains à une lecture plus symbolique et spirituelle. Fitzgerald ne tarde donc pas à répondre à Nicolas que son interprétation du personnage est fausse : le vin ne fait aucunement référence à la divinité, et le pauvre Monsieur Nicolas n’est que la victime de « l’endoctrinement des soufis » qu’il a fréquentés en Iran. [1] De nombreux intellectuels suivirent avec passion le débat, dont la presse se fit également l’écho. La controverse favorisa néanmoins une première réédition de la traduction de Fitzgerald et aida grandement à sa diffusion. La controverse entre Fitzgerald et Nicolas fut à l’origine de l’émergence de deux visions totalement différentes de Khayyâm en Angleterre et en France : Khayyâm demeura un hédoniste fataliste chez les Anglais, tandis que la conception d’un Khayyâm aux aspirations mystiques ou du moins plus ambigües s’enracina dans l’Hexagone.

Après la controverse entre Fitzgerald et Nicolas, Renan fut l’un des premiers à reprendre la plume sur le sujet : prenant davantage position pour la lecture littéraliste de Fitzgerald, il défendit la vision d’un Khayyâm dépravé et dissimulateur : « Mystique en apparence, débauché en réalité, hypocrite consommé, il mêlait le blasphème à l’hymne, le rire à l’incrédulité. » [2] Renan étudia également la personnalité de Khayyâm à travers la notion de « race » très en vogue à l’époque, pour faire de ce dernier l’archétype d’une endurance et d’un art de la dissimulation (taqiyya) qu’il qualifia de propre aux Aryens. Selon lui, c’est cette disposition qui a permis au cours de l’histoire aux Iraniens de conserver leur riche culture face à de nombreux envahisseurs. L’hypocrisie n’est donc pas ici blâmable, elle est au contraire le reflet d’une intelligence et d’une force de caractère.
Force est de constater que la plupart du temps, Khayyâm semble être un personnage où chacun projette ses propres espérances et craintes, et où se reflète les a priori ou les besoins de chaque auteur. Ainsi, Fitzgerald était lui-même un poète semble-t-il quelque peu désabusé et n’ayant pas réussi à trouver un sens réel à son existence. Il fait donc de Khayyâm son compagnon imaginaire, qui l’aide à sortir de son impasse en lui suggérant de jouir de l’instant présent et non de se noyer dans des tourments métaphysiques. La tendance mystique de Nicolas projetait au contraire sur le poète toutes ses aspirations à trouver un sens au monde au-delà du silence de la matière.

Théophile Gautier s’est également intéressé à plusieurs auteurs persans dont Khayyâm, qu’il découvrit de façon fortuite non pas chez un libraire, mais lors d’une promenade en canot sur la Seine en compagnie de sa fille Judith : ils y firent alors la rencontre d’un prénommé Mohsen Khân, en train de déclamer à voix haute un quatrain de Khayyâm, et qui s’avèrera être un diplomate iranien en mission à Paris à l’époque. Des liens d’amitiés se tissèrent entre le diplomate et Judith, qui permirent à cette dernière d’apprendre de nombreux quatrains qu’elle récitait ensuite à son père. [3] Mohsen Khân proposa ensuite à Judith de se marier avec lui et de le suivre en Perse, ce dont son père la dissuada. Cette rencontre permit ainsi à Théophile Gautier d’avoir un contact « vivant » avec les quatrains de Khayyâm, qui l’amena également à se poser la question de la personnalité de leur auteur : un libertin, tel que semble l’entendre Mohsen Khân, ou un mystique, comme l’affirme Nicolas ? Dans un article publié dans le Moniteur Universel, Gautier va livrer sa propre vision du personnage : ni mystique ni débauché, Gautier fait de lui une sorte de poète qui appréciait fort le vin de Neyshâbour sans être non plus insensible aux plaisirs immatériels. Loin d’être contradictoire, le vin joue au contraire le rôle de « pont » entre ces deux aspirations, l’ivresse matérielle permettant soi d’atteindre une certaine extase mystique, soi d’oublier le tourment des angoisses de ce monde. Gautier adopte donc une position médiane : « Khayyâm cherchait dans le vin cette ivresse extatique qui sépare les choses de la terre et enlève l’âme au sentiment de la réalité… Certes, de toutes les manières d’anéantir le corps pour exalter l’esprit, le vin est encore la plus douce, la plus naturelle, et, pour ainsi dire, la plus raisonnable. » [4] Plus loin, Gautier penche néanmoins davantage pour un Khayyâm fataliste, qui cherche à noyer sa détresse nihiliste dans la douceur du vin : « Quel profond sentiment du néant des hommes et des choses, et comme Horace, avec son carpe diem de bourgeois antique et son épicurisme goguenard est loin de cette annihilation mystique qui recherche dans l’ivresse l’oubli de tout et l’anéantissement de sa personnalité ! Kèyam ne s’exagère pas son importance, et jamais le peu qu’est l’homme dans l’infini de l’espace et du temps n’a été exprimé d’une façon plus vivre. » [5] Lorsqu’il rencontra Khayyâm, Gautier avait cependant rédigé la majorité de ses grandes œuvres ; l’influence de l’auteur des Robâiyât est donc peu présente dans ses écrits. Cette figure de poète aux élans tantôt mystiques tantôt nostalgiques fut reprise par certaines figures littéraires françaises. Ce fut notamment le cas du dramaturge Maurice Bouchor, qui publia en 1892 une pièce intitulée Le songe de Khéyam et y repris dans ses grandes lignes l’interprétation de Gautier. Quelques années plus tard, Jean Lahor écrivit un ouvrage mettant en scène Khayyâm intitulé Illusion : le poète iranien se fait l’écho des pensées de l’auteur concernant l’omniprésence de la mort et son inquiétude face à la fragilité de l’existence. Il évoque également la problématique de l’existence du mal : selon lui, les Aryens ont cherché la réponse à cette question dans plusieurs écoles de pensées : d’abord le panthéisme, puis le pessimisme et le nihilisme. Ils glissèrent vers le stoïcisme et fondèrent finalement l’humanisme, que Lahor décrit comme étant la religion par excellence. Dans cette esquisse de l’évolution de la pensée perse, il situe Khayyâm dans la fin de la première partie, comme recherchant un remède ultime aux souffrances du monde dans la jouissance et l’ivresse de chaque instant, pour échapper à l’idée et à la fatalité de la mort. Dans son ouvrage parsemé de vers, il reprend des images clés de l’œuvre de Khayyâm en évoquant constamment de beaux corps devenus terre, et de dialogues entre les morts et les vivants qui seront bientôt appelés à les rejoindre :
Cette poussière, cette ordure
Ces os épars étaient jadis
La forme lumineuse et pure
D’une femme aux blancheurs de lys,
Jetant des rayons de tendresse […]
Ce que vous êtes, nous l’étions ;
Vous serez ce que nous sommes.
Voici les sages près des fous ;
Plus de brunes ici, ni de blondes.
Vous qui passez, regardez-nous,
C’est le dénouement de ce monde. [6]

Khayyâm fut également l’objet d’attention d’André Gide, qui avait lu avec attention la traduction de Fitzgerald. Certains passages de son ouvrage Les nourritures terrestres ne sont ainsi pas sans rappeler certains thèmes des fameux quatrains. Comme les autres, Gide construisit « son » Khayyâm, dans lequel ses idées pouvaient trouver l’écho qu’il recherchait. Au début du XXe siècle, Khayyâm était connu par la majorité des écrivains et intellectuels français. En Angleterre, la traduction de Fitzgerald avait alors conquis de nombreux foyers. Dès la fin du XIXe siècle, tout un ensemble de clubs réservés aux admirateurs de Khayyâm furent fondés dans plusieurs pays d’Europe : il s’agissait pour certains de simples groupes de lecture et de partage d’une passion commune, tandis que pour d’autres, il s’agissait d’appliquer dans sa vie quotidienne la pensée – ou plutôt ce que l’on en comprenait – d’Omar Khayyâm. L’un des premiers du genre fut fondé en 1892 en Angleterre : il mêlait l’hédonisme à la vénération de Khayyâm et de Fitzgerald, mort près d’une décennie plus tôt. Sa traduction étant parue en 1859, il fut décidé que le nombre des membres du club n’excèderait pas 59 personnes. En 1900, un club du même genre fut fondé aux Etats-Unis. Il semble cependant que la France ne connût pas un tel phénomène : Khayyâm continuait de captiver plutôt l’attention d’écrivains et d’artistes isolés. Parallèlement à ces influences littéraires, de nouvelles traductions et recherches dont certaines étaient basées sur des sources persanes furent engagées. L’un de ces nouveaux traducteurs de Khayyâm fut Charles Grolleau, qui publia une nouvelle traduction des quatrains en 1902. Il fut bientôt suivi de Fernand Henry, qui proposa à son tour sa traduction des poèmes de Khayyâm.
Parallèlement à ces nouvelles traductions, une controverse concernant l’originalité de la pensée de Khayyâm éclata aux Etats-Unis à la même époque : tout commença lorsqu’un membre du club des omaristes américains prénommé Amin al-Rayhâni traduisit le recueil d’un poète syrien aveugle appelée Abou al-Alâ al-Ma’arri ayant vécu près d’un siècle avant Khayyâm, et dont les idées ressemblaient à s’y méprendre à celles exprimées dans les Robâiyât. De nombreuses discussions furent alors engagées sur l’authenticité de la pensée de Khayyâm : Al-Ma’arri avait-il influencé ce dernier ? Au même moment, une autre controverse concernant l’authenticité de la majorité des quatrains de Khayyâm fut lancée par des chercheurs comme l’iranologue Arthur Christensen, qui affirma que seulement une douzaine de quatrains pouvaient être attribués avec certitude à Khayyâm. Face à ce double affront, un ouvrage de Georges Salmon intitulé Un précurseur d’Omar Khayyam ou le poète aveugle dans lequel il compare les œuvres des deux poètes et en conclut que tout séparait en réalité ces deux auteurs : le contenu de leur œuvre, la distance géographique, et les dates. Toute influence était donc impossible.
La « projection » des inquiétudes sociales ou personnelles de différents écrivains français n’en continua pas moins par la suite : ainsi, en 1905, le poète et essayiste anarchiste Laurent Tailhade publia Omar Khayyam ou les poisons de l’intelligence où il louait les idées libertaires de Khayyâm tout en lui reprochant d’avoir abusé de ce qu’il appelait les « poisons de l’intelligence », c’est-à-dire le vin et tout ce qui altère la raison de l’individu – choses dont l’auteur avait semble-t-il lui-même abusé dans sa jeunesse. Le monologue permet donc de passer à une sorte de dialogue fictif mettant en scène Khayyâm comme le reflet de ses propres erreurs.
Durant la première décennie du XXe siècle, d’autres poètes tels que Jean-Marc Bernard ou Georges Salmon s’inspirèrent également de Khayyâm dans leurs œuvres.
Après la Première Guerre mondiale, le mouvement conjoint de traductions et d’influences se poursuivit. En 1920, Claude Anet, journaliste qui avait passé plusieurs années en Iran, publia une traduction des Robâiyât et fut suivi par une nouvelle traduction de Franz Toussaint agrémentée de nombreuses gravures. Pour la première fois, ce travail était le fruit d’une collaboration d’un Français avec un Iranien, Ali Nowrouz. Cet ouvrage illustré connut un grand succès et contribua à une diffusion encore plus importante de l’œuvre de Khayyâm.
Durant cette période, la question de l’authenticité des quatrains fut de nouveau discutée et reprise par le même Arthur Christensen, qui revit ses critères et affirma que près de 125 quatrains pouvaient être attribués avec certitude à Omar Khayyâm. La controverse resta cependant ouverte jusqu’à la découverte d’un manuscrit datant de 1259 par Arthur Arberry en Angleterre qui contenait 172 quatrains, qui n’étaient selon l’auteur du manuscrit qu’une « sélection ». D’autres découvertes de manuscrits à Téhéran et aux Etats-Unis suivirent et permirent d’invalider les thèses selon lesquelles les quatrains originaux de Khayyâm ne se limiteraient qu’à une dizaine.

L’influence sur les écrivains resta constante, notamment chez des écrivains comme Marguerite Yourcenar. En 1943, l’écrivain Alexandre Arnoux publia une œuvre où l’influence de Khayyâm est omniprésente intitulée CVII quatrains. Cette œuvre était parsemée de vers où étaient abordés les grands thèmes khayyâmiens de la mort, de la place de l’homme dans l’univers, et de la fragilité de l’existence. Il faisait ainsi de Khayyâm une sorte de philosophe naturaliste, loin du mystique présenté un siècle plus tôt pas Nicolas. Quelques années après, le poète belge Jean Kobs publia les Roses de la nuit, dont les poèmes reprenaient également les mêmes grandes thématiques des quatrains, et faisaient dialoguer morts et vivants. D’autres traductions furent réalisées, dont celles de Maurice Chapelain en 1969, qui reste considérée comme l’une des plus belles. Suivirent ensuite les traductions plus récentes, telles que celles de Gilbert Lazard ou encore de Vincent-Mansour Monteil.
Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, les Robâiyât de Khayyâm ont donc fait l’objet de l’attention de nombreux auteurs, poètes et dramaturges français. Si certains se sont juste contentés de les traduire, de nombreux auteurs se sont emparés du style et de certains motifs des quatrains pour y refléter leur propre pensée, engager un dialogue avec eux-mêmes et leur conception du monde, ou encore exprimer leurs inquiétudes existentielles et dénoncer certains maux de leur temps.
[1] Fitzgerald, Edward, Works, p. 13. Op cit : Hadidi, Javâd, De Sa’di à Aragon, l’accueil fait en France à la littérature persane (1600-1982), Al-Hodâ, Téhéran, 1999.
[2] Journal Asiatique, juillet-août 1868, pp. 56-57. Op cit : Hadidi, Javâd, De Sa’di à Aragon, l’accueil fait en France à la littérature persane (1600-1982), Al-Hodâ, Téhéran, 1999.
[3] Judith Gautier évoque cette rencontre dans son ouvrage intitulé Le second rang du collier.
[4] Gautier, Théophile, L’Orient, II, 82. Op cit : Hadidi, Javâd, De Sa’di à Aragon, l’accueil fait en France à la littérature persane (1600-1982), Al-Hodâ, Téhéran, 1999.
[5] Ibid.
[6] Lahor, Jean, Illusion, p. 27. Op cit : Hadidi, Javâd, De Sa’di à Aragon, l’accueil fait en France à la littérature persane (1600-1982), Al-Hodâ, Téhéran, 1999.
Quelques œuvres de Khayyâm![]() Zidj-e Mâlekshâhi (Les tables astronomiques)
Zidj-e Mâlekshâhi (Les tables astronomiques)![]() Resâleh dar sehat-e toroq-e hendesi barâye estekhrâj djazr va ka’b (Méthode pour l’extraction des racines carrées et cubiques)
Resâleh dar sehat-e toroq-e hendesi barâye estekhrâj djazr va ka’b (Méthode pour l’extraction des racines carrées et cubiques)![]() Risâla fi Barâhin alâ Masâ’il al-Jabr wa al-Moghâbila (Traité des démonstrations de problèmes d’algèbre)Risâla fi sharh iskhâl mâ min Mosâdirât Kitâb Oqlidos (Traité sur quelques difficultés des définitions d’Euclide)Robâiyât
Risâla fi Barâhin alâ Masâ’il al-Jabr wa al-Moghâbila (Traité des démonstrations de problèmes d’algèbre)Risâla fi sharh iskhâl mâ min Mosâdirât Kitâb Oqlidos (Traité sur quelques difficultés des définitions d’Euclide)Robâiyât![]() Poèmes arabes
Poèmes arabes![]() La traduction persane du sermon d’Avicenne sur le monothéisme
La traduction persane du sermon d’Avicenne sur le monothéisme
Bibliographie :![]() Mostafâ Badkoubeyi Hezâveyi, Nâbegheh-ye Neyshâbour (Le génie de Neyshâbour), éd. Farâyen, 1995.
Mostafâ Badkoubeyi Hezâveyi, Nâbegheh-ye Neyshâbour (Le génie de Neyshâbour), éd. Farâyen, 1995.![]() Djavâd Barkhordâr, “Khayyâm-e Dâneshmand” (Khayyâm le savant), in revue Dâneshmand, n° 588, 2010.
Djavâd Barkhordâr, “Khayyâm-e Dâneshmand” (Khayyâm le savant), in revue Dâneshmand, n° 588, 2010.![]() Djahânguir Hedâyat, Khayyâm-e Sâdegh (Le Khayyâm de Sâdegh)(Ensemble des œuvres de Sâdegh Hedâyat sur Khayyâm), Téhéran, éd. Tcheshmeh, 2005.
Djahânguir Hedâyat, Khayyâm-e Sâdegh (Le Khayyâm de Sâdegh)(Ensemble des œuvres de Sâdegh Hedâyat sur Khayyâm), Téhéran, éd. Tcheshmeh, 2005.![]() Seyyed Akbar Mir Ja’fari, “Hakim Omar Khayyâm”, in revue Moa’llem, n°16, mai 2007
Seyyed Akbar Mir Ja’fari, “Hakim Omar Khayyâm”, in revue Moa’llem, n°16, mai 2007![]() Abolfazl Mohâdjer, « Pir-e Pegâh khiz » (Le Maître matinal), in Hamshahri, le 18 mai 2005.
Abolfazl Mohâdjer, « Pir-e Pegâh khiz » (Le Maître matinal), in Hamshahri, le 18 mai 2005.![]() Ruba’iyat, trilingue (anglais, français, persan), avec l’introduction de Saïd Nafissi, Téhéran, éd. Namak, 2004.
Ruba’iyat, trilingue (anglais, français, persan), avec l’introduction de Saïd Nafissi, Téhéran, éd. Namak, 2004.![]() http://www.khayyam.info/persian/khayyam_persian09.htm
http://www.khayyam.info/persian/khayyam_persian09.htm
![]() Hadidi, Javâd, De Sa’di à Aragon, l’accueil fait en France à la littérature persane (1600-1982), Al-Hodâ, Téhéran, 1999.
Hadidi, Javâd, De Sa’di à Aragon, l’accueil fait en France à la littérature persane (1600-1982), Al-Hodâ, Téhéran, 1999.![]() Fitzgerald, Edward, Rubaiyat of Omar Khayyam, edited by Daniel Karlin, Oxford University Press, 2009.
Fitzgerald, Edward, Rubaiyat of Omar Khayyam, edited by Daniel Karlin, Oxford University Press, 2009.
00:05 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : omar khayyam, iran, littérature, lettres, littérature perse, littérature iranienne, littérature française, lettres perses, lettres iraniennes, lettres françaises, 19ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Céline ? C'est Ça !... de Serge KANONY
00:05 Publié dans Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, livre, lettres, lettres françaises, littérature française, céline |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Robert Steuckers:
Version abrégée de: http://robertsteuckers.blogspot.be/2012/10/henry-bauchau-un-temoin-sen-est-alle.html/ ).
Dès le début des années 30, en août 1931 pour être exact, l’épiscopat et la direction cléricale de l’Université de Louvain, décident d’organiser un colloque où Léopold Levaux (disciple et exégète de Léon Bloy), le Recteur Magnifique Monseigneur Ladeuze, l’Abbé Jacques Leclercq (dont l’itinéraire intellectuel était parti des rénovateurs-modernisateurs du catholicisme, tels Jacques Maritain et Emmanuel Mounier, pour aboutir à une sorte de catho-communisme après 1945, avec l’apparition sur le théâtre de la politique belge d’un mouvement comme l’UDB qui restera éphémère) et... Léon Degrelle. On le voit: dès août 1931, le catholicisme belge va osciller entre diverses interprétations de son message éthique et social, entre “gauche” et “droite”, selon le principe de la “coïncidentia oppositorum” (chère à un Carl Schmitt en Allemagne). Dans le cadre de ces activités multiples, Bauchau se liera d’amitié à Raymond De Becker, celui que l’on nomme aujourd’hui, en le tirant de l’oubli, l’ “électron libre”, l’homme-orchestre qui, bouillonnant, va tenter de concilier toutes les innovations idéologiques, réclamant la justice sociale, qui émergeront dans les années 30. Quand De Man lance son idée planiste et critique le matérialisme outrancier des sociales-démocraties belge et allemande, De Becker, lié à Maritain et au mouvement “Esprit” de Mounier, cherchera à faire vivre une synthèse entre néo-socialisme (demaniste) et tradition catholique rénovée, où l’accent sera mis sur la mystique et l’ascèce plutôt que sur les bondieuseries superficielles et l’obéissance perinde ac cadaver du cléricalisme disciplinaire. Cet humaniste personnaliste, que fut De Becker, a cru que le bonheur arrivait enfin dans le royaume quand les catholiques ont formé une coalition avec les socialistes (où De Man était la figure de proue intellectuelle). Pour De Becker, et pour Bauchau dans son sillage, les éléments jeunes, qui cherchaient cette synthèse et voulaient jeter aux orties les scories du régime vieilli, aspiraient à un “ordre nouveau” (titre d’une brochure de De Becker dont la couverture a été illustrée par Hergé), un ordre qui ne serait pas une nouveauté radicale, respect des traditions morales oblige, mais une synthèse innovante qui unirait ce qu’il y a de meilleur dans les partis établis, débarrassés de leurs tares, héritage du “vieux monde” libéral, du “stupide 19ème siècle” selon Léon Daudet. Mais l’émergence du mouvement Rex de Degrelle déforce les catholiques dans le nouveau binôme politique formé avec les socialistes de Spaak et de De Man. L’Etat organique des forces jeunes, catholiques et néo-socialistes, n’advient donc pas. La guerre, plus que l’aventure rexiste, va briser la cohésion que ces milieux bouillonnants où De Becker jouait un rôle prépondérant. Disons-le une bonne fois pour toutes: c’est cette “déchirure” au sein des mouvements catholiques personnalistes et droitistes qui a envenimé définitivement la “question belge”, jusqu’à la crise de 2007-2011. Dans l’espace culturel flamand, la crise éthico-identitaire s’est déployée selon un autre rythme (plutôt plus lent) mais, inexorablement, avec les boulevedrsements dans les mentalités qu’a apporté mai 68, une mutation quasi anthropologique qui a notamment suscité les admonestations du nationaliste ex-expressionniste Wies Moens, alors professeur à Geelen dans le Limbourg néerlandais, le déclin éthique n’a pas pu être enrayé par un mouvement conservateur, “katéchonique”. Ni en Flandre ni a fortiori en Wallonie.
Avec la défaite de 1940, ce mouvement à facettes multiples va se disperser et, surtout, va être tiraillé entre l’“option belge” (la “politique de présence”), la collaboration, la résistance (royaliste) et l’engouement, dès les déboires de l’Axe en Afrique et en Russie, de certains anciens personnalistes (De Becker excepté) qui vireront au catho-communisme dès la fin de l’occupation allemande. Bauchau oscillera de l’option belge à la résistance royaliste (Armée Secrète). De Becker voudra une collaboration dans le cadre strict de la “politique de présence”. Degrelle jouera la carte collaborationniste à fond. Les adeptes de l’Abbé Leclercq opteront pour l’orientation personnaliste de Maritain et Mounier et chercheront un modus vivendi avec les forces de gauches, communistes compris.
Bauchau, dès le début de l’occupation, tentera de mettre sur pied un “Service du Travail Volontaire pour la Wallonie”, qui avait aussi un équivalent flamand. Ce Service devait aider à effacer du pays les traces de toutes les destructions laissées par la campagne des Dix-Huit Jours. Les Volontaires wallons aideront les populations sinistrées, notamment lors de l’explosion d’une usine chimique à Tessenderloo ou suite au bombardement américain du quartier de l’Avenue de la Couronne à Etterbeek. Il avait aussi pour ambition tacite de soustraire des jeunes gens au travail obligatoire en Allemagne. Les tiraillements d’avant juin 1940, entre catholiques personnalistes d’orientations diverses, favorables soit à Rex soit à un “Ordre Nouveau” à construire avec les jeunes catholiques et socialistes (demanistes), vont se répercuter dans la collaboration, première phase. De Becker refusera toute hégémonie rexiste sur la partie romane du pays. Il oeuvrera à l’émergence d’un “parti unique des provinces romanes”, qui ne recevra pas l’approbation de l’occupant et essuiera les moqueries (et les menaces) de Degrelle. La situation tendue de cette année 1942 nous est fort bien expliquée par l’historien britannique Martin Conway (in: Collaboration in Belgium, Léon Degrelle and the Rexist Movement, Yale University Press, 1993). La fin de non recevoir essuyée par De Becker et ses alliés de la collaboration à option belge et le blanc-seing accordé par l’occupant aux rexistes va provoquer la rupture. Bauchau avait certes marqué son adhésion à la constitution du “parti unique des provinces romanes”, mais le remplacement rapide des cadres de son SVTW par des militants rexistes entraîne sa démission et son glissement progressif vers la résistance royaliste. De Becker lui-même finira par démissionner, y compris de son poste de rédacteur en chef du “Soir”, arguant que les chances de l’Axe étaient désormais nulles depuis l’éviction de Mussolini par le Grand Conseil Fasciste pendant l’été 1943.
 Bauchau participe aux combats de la résistance dans la région de Brumagne (près de Namur), y est blessé. Mais, malgré cet engagement, il doit rendre des comptes à l’auditorat militaire, pour sa participation au SVTW et surtout, probablement, pour avoir signé le manifeste de fondation du “parti unique (avorté) des provinces romanes”. Il échappe à tout jugement mais est rétrogradé: de Lieutenant, il passe sergeant. Il en est terriblement meurtri. Sa patrie, qu’il a toujours voulu servir, le dégoûte. Il s’installe à Paris dès 1946. Mais cet exil, bien que captivant sur le plan intellectuel puisque Bauchau est éditeur dans la capitale française, est néanmoins marqué par le désarroi: c’est une déchirure, un sentiment inaccepté de culpabilité, un tiraillement constant entre les sentiments paradoxaux (l’oxymore dit-on aujourd’hui) d’avoir fait son devoir en toute loyauté et d’avoir, malgré cela, été considéré comme un “traître”, voire, au mieux, comme un “demi-traître”, dont on se passera dorénavant des services, que l’on réduira au silence et à ne plus être qu’une sorte de citoyen de seconde zone, dont on ne reconnaîtra pas la valeur intrinsèque. A ce malaise tenace, Bauchau échappera en suivant un traitement psychanalytique chez Blanche Reverchon-Jouve. Celle-ci, d’inspiration jungienne, lui fera prendre conscience de sa personnalité vraie: sa vocation n’était pas de faire de la politique, de devenir un chef au sens où on l’entendait dans les années 30, mais d’écrire. Seules l’écriture et la poésie lui feront surmonter cette “déchirure”, qu’il lui faudra accepter et en laquelle, disait la psychanalyste française, il devra en permanence se situer pour produire son oeuvre: ce sont les sentiments de “déchirure” qui font l’excellence de l’écrivain et non pas les “certitudes” impavides de l’homme politisé.
Bauchau participe aux combats de la résistance dans la région de Brumagne (près de Namur), y est blessé. Mais, malgré cet engagement, il doit rendre des comptes à l’auditorat militaire, pour sa participation au SVTW et surtout, probablement, pour avoir signé le manifeste de fondation du “parti unique (avorté) des provinces romanes”. Il échappe à tout jugement mais est rétrogradé: de Lieutenant, il passe sergeant. Il en est terriblement meurtri. Sa patrie, qu’il a toujours voulu servir, le dégoûte. Il s’installe à Paris dès 1946. Mais cet exil, bien que captivant sur le plan intellectuel puisque Bauchau est éditeur dans la capitale française, est néanmoins marqué par le désarroi: c’est une déchirure, un sentiment inaccepté de culpabilité, un tiraillement constant entre les sentiments paradoxaux (l’oxymore dit-on aujourd’hui) d’avoir fait son devoir en toute loyauté et d’avoir, malgré cela, été considéré comme un “traître”, voire, au mieux, comme un “demi-traître”, dont on se passera dorénavant des services, que l’on réduira au silence et à ne plus être qu’une sorte de citoyen de seconde zone, dont on ne reconnaîtra pas la valeur intrinsèque. A ce malaise tenace, Bauchau échappera en suivant un traitement psychanalytique chez Blanche Reverchon-Jouve. Celle-ci, d’inspiration jungienne, lui fera prendre conscience de sa personnalité vraie: sa vocation n’était pas de faire de la politique, de devenir un chef au sens où on l’entendait dans les années 30, mais d’écrire. Seules l’écriture et la poésie lui feront surmonter cette “déchirure”, qu’il lui faudra accepter et en laquelle, disait la psychanalyste française, il devra en permanence se situer pour produire son oeuvre: ce sont les sentiments de “déchirure” qui font l’excellence de l’écrivain et non pas les “certitudes” impavides de l’homme politisé.
En 1951, après avoir oeuvré sans relâche à la libération de son ami Raymond De Becker, qu’il n’abandonnera jamais, Bauchau s’installe en Suisse à Gstaad où il crée un Institut, l’Institut Montesano, un collège pour jeunes filles (surtout américaines). Il y enseignera la littérature et l’histoire de l’art, comme il l’avait fait, avant-guerre, dans une “université” parallèle qui dispensait ses cours dans les locaux de l’Institut Saint-Louis de Bruxelles ou dans un local de la rue des Deux-Eglises à Saint-Josse et à laquelle participait également le philosophe liégeois Marcel De Corte. Son oeuvre littéraire ne démarrera qu’en 1958, avec la publication d’un premier recueil de poésie, intitulé Géologie. En 1972, sort un roman qui obtiendra le “Prix Franz Hellens” à Bruxelles et le “Prix d’honneur” à Paris. Ce roman a pour toile de fond la Guerre de Sécession aux Etats-Unis, période de l’histoire qui avait toujours fasciné son père, décédé en 1951. Dans son roman, Bauchau fait de son père un volontaire dans le camp nordiste qui prend la tête d’un régiment composé d’Afro-Américains cherchant l’émancipation.
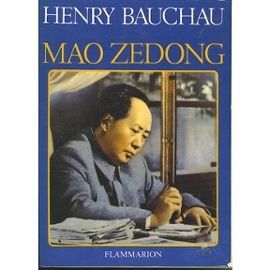 En 1973, l’Institut Montesano ferme ses portes: la crise du dollar ne permettant plus aux familles américaines fortunées d’envoyer en Suisse des jeunes filles désirant s’immerger dans la culture européenne traditionnelle. A cette même époque, comme beaucoup d’anciennes figures de la droite à connotations personnalistes, Bauchau subit une tentation maoïste, une sorte de tropisme chinois (comme Hergé!) qui va bien au-delà des travestissements marxistes que prenait la Chine des années 50, 60 et 70. Notre auteur s’attèle alors à la rédaction d’une biographie du leader révolutionnaire chinois, Mao Tse-Toung, qu’il n’achèvera qu’en 1980, quand les engouements pour le “Grand Timonnier” n’étaient déjà plus qu’un souvenir (voire un objet de moquerie, comme dans les caricatures d’un humoriste flamboyant comme Lauzier).
En 1973, l’Institut Montesano ferme ses portes: la crise du dollar ne permettant plus aux familles américaines fortunées d’envoyer en Suisse des jeunes filles désirant s’immerger dans la culture européenne traditionnelle. A cette même époque, comme beaucoup d’anciennes figures de la droite à connotations personnalistes, Bauchau subit une tentation maoïste, une sorte de tropisme chinois (comme Hergé!) qui va bien au-delà des travestissements marxistes que prenait la Chine des années 50, 60 et 70. Notre auteur s’attèle alors à la rédaction d’une biographie du leader révolutionnaire chinois, Mao Tse-Toung, qu’il n’achèvera qu’en 1980, quand les engouements pour le “Grand Timonnier” n’étaient déjà plus qu’un souvenir (voire un objet de moquerie, comme dans les caricatures d’un humoriste flamboyant comme Lauzier).
Bauchau quitte la Suisse en 1975 et s’installe à Paris, comme psychothérapeute dans un hôpital pour adolescents en difficulté. Il enseigne à l’Université de Paris VII sur les rapports art/psychanalyse. En 1990, il publie Oedipe sur la route, roman situé dans l’antiquité grecque, axé sur la mythologie et donc aussi sur l’inconscient que les mythes recouvrent et que la psychanalyse jungienne cherche à percer. La publication de ce roman lui vaut une réhabilitation définitive en Belgique: il est élu à l’Académie Royale de Langue et de Littérature Française du royaume. Plus tard, son roman Antigone lui permet de s’immerger encore davantage dans notre héritage mythologique grec, source de notre psychè profonde, explication imagée de nos tourments ataviques.
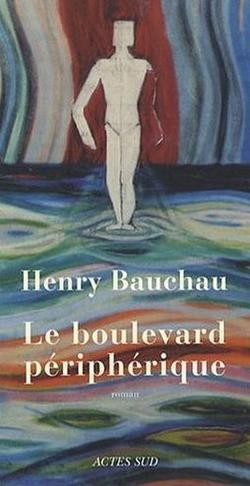 Bauchau est également un mémorialiste de premier plan, que nous pourrions comparer à Ernst Jünger (qu’il cite assez souvent). Les journaux de Bauchau permettent effectivement de suivre à la trace le cheminement mental et intellectuel de l’auteur: en les lisant, on perçoit de plus en plus une immersion dans les mystiques médiévales —et il cite alors fort souvent Maître Eckart— et dans les sagesses de l’Orient, surtout chinois. On perçoit également en filigrane une lecture attentive de l’oeuvre de Martin Heidegger. Ce passage, à l’âge mûr, de la frénésie politique (politicienne?) à l’approfondissement mystique est un parallèle de plus à signaler entre le Wallon belge Bauchau et l’Allemand Jünger.
Bauchau est également un mémorialiste de premier plan, que nous pourrions comparer à Ernst Jünger (qu’il cite assez souvent). Les journaux de Bauchau permettent effectivement de suivre à la trace le cheminement mental et intellectuel de l’auteur: en les lisant, on perçoit de plus en plus une immersion dans les mystiques médiévales —et il cite alors fort souvent Maître Eckart— et dans les sagesses de l’Orient, surtout chinois. On perçoit également en filigrane une lecture attentive de l’oeuvre de Martin Heidegger. Ce passage, à l’âge mûr, de la frénésie politique (politicienne?) à l’approfondissement mystique est un parallèle de plus à signaler entre le Wallon belge Bauchau et l’Allemand Jünger.
L’an passé, Bauchau, à 98 ans, a sorti un recueil poignant de souvenirs, intitulé L’enfant rieur. Dans cet ouvrage, il nous replonge dans les années 30, avec l’histoire de son service militaire dans la cavalerie, avec les tribulations de son premier mariage (qui échouera) et surtout les souvenirs de “Raymond” qu’il n’abandonnera pas, sans oublier les mésaventures du mobilisé Bauchau lors de la campagne des Dix-Huit Jours. Bauchau promettait une suite à ces souvenirs de jeunesse, si la vie lui permettait encore de voir une seule fois tomber les feuilles... Il est mort le jour de l’équinoxe d’automne 2012. Il n’a pas vu les feuilles tomber, comme il le souhaitait, mais le manuscrit, même inachevé, sera sûrement confié à son éditeur, “Actes Sud”.
Bauchau n’est plus un “réprouvé”, comme il l’a longtemps pensé avec grande amertume. Un institut s’occupe de gérer son oeuvre à Louvain-la-Neuve. Les “Archives & Musée de la Littérature” de la Bibliothèque Royale recueille , sous la houlette de son exégète et traductrice allemande Anne Neuschäfer (université d’Aix-la-Chapelle), tous les documents qui le concerne (http://aml.cfwb.be/bauchau/html/ ). A Louvain-la-Neuve, Myriam Watthée-Delmotte se décarcasse sans arrêt pour faire connaître l’oeuvre dans son intégralité, sans occulter les années 30 ni l’effervescence intellecutelle et politique de ces années décisives.
Et en effet, il faudra immanquablement se replonger dans les vicissitudes de cette époque; le Prof. Jean Vanwelkenhuizen avait déjà sorti un livre admirable sur l’année 1936, montrant que les jugements à l’emporte-pièce sur la politique de neutralité, sur l’émergence du rexisme, sur la guerre d’Espagne et sur le Front Populaire français, n’étaient plus de mise. Cécile Vanderpelen-Diagre, dans Ecrire en Belgique sous le regard de Dieu, avait, à l’ULB, dressé un panorama général de l’univers intellectuel catholique de 1890 à 1945. Jean-François Fuëg (ULB), pour sa part, nous narre l’histoire du mouvement anarchisant autour de la revue et du cercle “Le Rouge et Noir” de Bruxelles, où l’on s’aperçoit que l’enthousiasme pour la politique de neutralité de Léopold III n’a pas été la marque d’une certaine droite conservatrice (autour de Robert Poulet) mais a eu des partisans à gauche. Enfin, Eva Schandevyl (VUB) nous dresse un portrait des gauches belges de 1918 à 1956, où elle ne fait nullement l’impasse sur le formidable espoir que les idées de De Man avait suscité dans les années 30. Mieux: les Facultés Universitaires Saint-Louis ont consacré en avril dernier un colloque à la mémoire de Raymond De Becker, initiative en rupture avec les poncifs dominants qui avait fait hurler de fureur un plumitif lié aux “rattachistes wallingants”.
Le chantier est ouvert. Comprendre l’oeuvre de Bauchau, mais aussi la trajectoire post bellum de De Becker et d’Hergé, est impossible sans revenir aux sources, donc aux années 30. Mais un retour qui doit s’opérer sans les oeillères habituelles, sans les schématismes nés des hyper-simplifications staliniennes et libérales, pour lesquelles les actions etl es pensées du “zoon politikon” doivent se réduire à quelques slogans simplistes que Big Brother manipule et transforme au gré des circonstances.
Robert Steuckers.
(Forest-Flotzenberg, 26 octobre 2012).
22:48 Publié dans Belgicana, Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : belgique, belgicana, lettres, lettres belges, lettres françaises, littérature, littérature belge, littérature française, henry bauchau |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Robert STEUCKERS:
Henry Bauchau: un témoin s’en est allé...
La disparition récente d’Henry Bauchau, en ce mois de septembre 2012, atteste surtout, dans les circonstances présentes, de la disparition d’un des derniers témoins importants de la vie politique et intellectuelle de nos années 30 et du “non-conformisme” idéologique de Belgique francophone, un non-conformisme que l’on mettra en parallèle avec celui de ses homologues français, décrits par Jean-Louis Loubet-del Bayle ou par Paul Sérant.
Pour Henry Bauchau, et son ancien compagnon Raymond De Becker, comme pour bien d’autres acteurs contemporains issus du monde catholique belge, l’engagement des années 30 est un engagement qui revendique la survie d’abord, la consolidation et la victoire ensuite, d’une rigueur éthique (traditionnelle) qui ployait alors sous les coups des diverses idéologies modernes, libérales, socialistes ou totalitaires, qui toutes voulaient s’en débarrasser comme d’une “vieille lune”; cette rigueur éthique avait tendance à s’estomper sous les effets du doute induit par ce que d’aucuns nommaient “les pensées ou les idéologies du soupçon”, notamment Monseigneur Van Camp, ancien Recteur des Facultés Universitaires Saint Louis, un ecclésiastique philosophe et professeur jusqu’à la fin de sa vie. Cette exigence d’éthique, formulée par Bauchau et De Becker sur fond de crise des années 30, sera bien entendu vilipendée comme “fasciste”, ou au moins comme “fascisante”, par quelques terribles simplificateurs du journalisme écrit et télévisé actuel. Formuler de telles accusations revient à énoncer des tirades à bon marché, bien évidemment hors de tout contexte. Quel fut ce contexte? D’abord, la crise sociale de 1932 et la crise financière de 1934 (où des banques font faillite, plument ceux qui leur ont fait confiance et réclament ensuite l’aide de l’Etat...) amènent au pouvoir des cabinets mixtes, catholiques et socialistes. L’historien et journaliste flamand Rolf Falter, dans “België, een geschiedenis zonder land” (2012) montre bien que c’était là, dans le cadre belge d’alors, une nouveauté politique inédite, auparavant impensable car personne n’imaginait qu’aurait été possible, un jour, une alliance entre le pôle clérical, bien ancré dans la vie associative des paroisses, et le parti socialiste, athée et censé débarrasser le peuple de l’opium religieux.
Un bloc catholiques/socialistes?
Les premiers gouvernements catholiques/socialistes ont fait lever l’espoir, dans toute la génération née entre 1905 et 1920, de voir se constituer un bloc uni du peuple derrière un projet de société généreux, alliant éthique rigoureuse, sens du travail (et de l’ascèse) et justice sociale. Face à un tel bloc, les libéraux, posés comme l’incarnation politique des égoïsmes délétères de la bourgeoisie, allaient être définitivement marginalisés. Catholiques et socialistes venaient cependant d’horizons bien différents, de mondes spécifiques et bien cloisonnés: la foi des uns et le matérialisme doctrinaire des autres étaient alors comme l’eau et le feu, antagonistes et inconciliables. La génération de Bauchau et de De Becker, surtout la fraction de celle-ci qui suit l’itinéraire de l’Abbé Jacques Leclerq, va vouloir résoudre cette sorte de quadrature du cercle, oeuvrer pour que la soudure s’opère et amène les nouvelles et les futures générations vers une Cité harmonieuse, reflet dans l’en-deça de la Cité céleste d’augustinienne mémoire, où la vie politique serait entièrement déterminée par le bloc uni, appellé à devenir rapidement majoritaire, par la force des choses, par la loi des urnes, pour le rester toujours, ou du moins fort longtemps. Henri De Man, leader des socialistes et intellectuel de grande prestance, avait fustigé le matérialisme étroit des socialistes allemands et belges, d’une sociale-démocratie germanique qui avait abandonné, dès la première décennie du siècle, ses aspects ludiques, nietzschéo-révolutionnaires, néo-religieux, pour les abandonner d’abord aux marges de la “droite” sociologique ou du mouvement de jeunesse ou des cénacles d’artistes “Art Nouveau”, “Jugendstil”. De Man avait introduit dans le corpus doctrinal socialiste l’idée de dignité (Würde) de l’ouvrier (et du travail), avait réclamé une justice sociale axée sur une bonne prise en compte de la psychologie ouvrière et populaire. Les paramètres rigides du matérialisme marxiste s’étaient estompés dans la pensée de De Man: bon nombre de catholiques, dont Bauchau et De Becker, chercheront à s’engouffrer dans cette brèche, qui, à leurs yeux, rendait le socialisme fréquentable, et à servir un régime belge entièrement rénové par le nouveau binôme socialistes/catholiques. Sur le très long terme, ce régime “jeune et nouveau” reposerait sur ces deux piliers idéologiques, cette fois ravalés de fond en comble, et partageant des postulats idéologiques ou religieux non individualistes, en attendant peut-être la fusion en un parti unique, apte à effacer les tares de la partitocratie parlementaire, à l’époque fustigées dans toute l’Europe. Pour De Becker, la réponse aux dysfonctionnements du passé résidait en la promotion d’une éthique “communautaire”, inspirée par le réseau “Esprit” d’Emmanuel Mounier et par certaines traditions ouvrières, notamment proudhoniennes; c’est cette éthique-là qui devait structurer le nouvel envol socialo-catholique de la Belgique.
Les jeunes esprits recherchaient donc une philosophie, et surtout une éthique, qui aurait fusionné, d’une part, l’attitude morale irréprochable qu’une certaine pensée catholique, bien inspirée par Léon Bloy, prétendait, à tort ou à raison, être la sienne et, d’autre part, un socialisme sans corsets étouffants, ouvert à la notion immatérielle de dignité. Les “daensistes” démocrates-chrétiens et les résidus de la “Jeune Droite” de Carton de Wiart, qui avaient réclamé des mesures pragmatiques de justice sociale, auraient peut-être servi de passerelles voire de ciment. Toute l’action politique de Bauchau et de De Becker dans des revues comme “La Cité chrétienne” (du Chanoine Jacques Leclercq) ou “L’Esprit nouveau” (de De Becker lui-même) viseront à créer un “régime nouveau” qu’on ne saurait confondre avec ce que d’aucuns, plus tard, et voulant aussi oeuvrer à une régénération de la Cité, ont appelé l’“ordre nouveau”. Cette attitude explique la proximité du tandem Bauchau/De Becker avec les socialistes De Man, jouant son rôle de théoricien, et Spaak, représentant le nouvel espoir juvénile et populaire du POB (“Parti Ouvrier Belge”). Et elle explique aussi que le courant n’est jamais passé entre ce milieu, qui souhaitait asseoir la régénération de la Cité sur un bloc catholiques/socialistes, inspiré par des auteurs aussi divers que Bloy, Maritain, Maurras, Péguy, De Man, Mounier, etc., et les rexistes de Léon Degrelle, non pas parce que l’attitude morale des rexistes était jugée négative, mais parce que la naissance de leur parti empêchait l’envol d’un binôme catholiques/socialistes, appelé à devenir le bloc uni, soudé et organique du peuple tout entier. Selon les termes mêmes employés par De Becker: “un nouveau sentiment national sur base organique”.
Pour Léo Moulin, venu du laïcisme le plus caricatural d’Arlon, il fallait jeter les bases “d’une révolution spirituelle”, basée sur le regroupement national de toutes les forces démocratiques mais “en dehors des partis existants” (Moulin veut donc la création d’un nouveau parti dont les membres seraient issus des piliers catholiques et socialistes mais ne seraient plus les vieux briscards du parlement), en dehors des gouvernements dits “d’union nationale” (c’est-à-dire des trois principaux partis belges, y compris les libéraux) et sans se référer au modèle des “fronts populaires” (c’est-à-dire avec les marxistes dogmatiques, les communistes ou les bellicistes anti-fascistes). L’option choisie fin 1936 par Emmanuel Mounier de soutenir le front populaire français, puis son homologue espagnol jeté dans la guerre civile suite à l’alzamiento militaire, consacrera la rupture entre les personnalistes belges autour de De Becker et Bauchau et les personnalistes français, remorques lamentables des intrigues communistes et staliniennes. Les pôles personnalistes belges ont fait davantage preuve de lucidité et de caractère que leurs tristes homologues parisiens; dans “L’enfant rieur”, dernier ouvrage autobiographique de Bauchau (2011), ce dernier narre le désarroi qui règnait parmi les jeunes plumes de la “Cité chrétienne” et du groupe “Communauté” lorsque l’épiscopat prend fait et cause pour Franco, suite aux persécutions religieuses du “frente popular”. Contrairement à Mounier (ou, de manière moins retorse, à Bernanos), il ne sera pas question, pour les disciples du Chanoine Leclercq, de soutenir, de quelque façon que ce soit, les républicains espagnols.
La naissance du parti rexiste dès l’automne 1935 et sa victoire électorale de mai 1936, qui sera toutefois sans lendemain vu les ressacs ultérieurs, freinent provisoirement l’avènement de cette fusion entre catholiques/socialistes d’”esprit nouveau”, ardemment espérée par la nouvelle génération. Le bloc socialistes/catholiques ne parvient pas à se débarrasser des vieux exposants de la social-démocratie: De Man déçoit parce qu’il doit composer. Avec le départ des rexistes hors de la vieille “maison commune” des catholiques, ceux-ci sont déforcés et risquent de ne pas garder la majorité au sein du binôme... De Becker avait aussi entraîné dans son sillage quelques communistes originaux et “non dogmatiques” comme War Van Overstraeten (artiste-peintre qui réalisara un superbe portrait de Bauchau), qui considérait que l’anti-fascisme des “comités”, nés dans l’émigration socialiste et communiste allemande (autour de Willy Münzenberg) et suite à la guerre civile espagnole, était lardé de “discours creux”, qui, ajoutait le communiste-artiste flamand, faisaient le jeu des “puissances impérialistes” (France + Angleterre) et empêchaient les dialogues sereins entre les autres peuples (dont le peuple allemand d’Allemagne et non de l’émigration); De Becker entraîne également des anarchistes sympathiques comme le libertaire Ernestan (alias Ernest Tanrez), qui s’activait dans le réseau de la revue et des meetings du “Rouge et Noir”, dont on commence seulement à étudier l’histoire, pourtant emblématique des débats d’idées qui animaient Bruxelles à l’époque.
On le voit, l’effervescence des années de jeunesse de Bauchau est époustouflante: elle dépasse même la simple volonté de créer une “troisième voie” comme on a pu l’écrire par ailleurs; elle exprime plutôt la volonté d’unir ce qui existe déjà, en ordre dispersé dans les formations existantes, pour aboutir à une unité nationale, organique, spirituelle et non totalitaire. L’espoir d’une nouvelle union nationale autour de De Man, Spaak et Van Zeeland aurait pu, s’il s’était réalisé, créer une alternative au “vieux monde”, soustraite aux tentations totalitaires de gauche ou de droite et à toute influence libérale. Si l’espoir de fusionner catholiques et socialistes sincères dans une nouvelle Cité —où “croyants” et “incroyants” dialogueraient, où les catholiques intransigeants sur le plan éthique quitteraient les “ghettos catholiques” confis dans leurs bondieuseries et leurs pharisaïsmes— interdisait d’opter pour le rexisme degrellien, il n’interdisait cependant pas l’espoir, clairement formulé par De Becker, de ramener des rexistes, dont Pierre Daye (issu de la “Jeune Droite” d’Henry Carton de Wiart), dans le giron de la Cité nouvelle si ardemment espérée, justement parce que ces rexistes alliaient en eux l’âpre vigueur anti-bourgeoise de Bloy et la profondeur de Péguy, défenseur des “petites et honnêtes gens”. C’est cet espoir de ramener les rexistes égarés hors du bercail catholique qui explique les contacts gardés avec José Streel, idéologue rexiste, jusqu’en 1943. Streel, rappelons-le, était l’auteur de deux thèses universitaires: l’une sur Bergson, l’autre sur Péguy, deux penseurs fondamentaux pour dépasser effectivement ce monde vermoulu que la nouvelle Cité spiritualisée devait mettre définitivement au rencart.
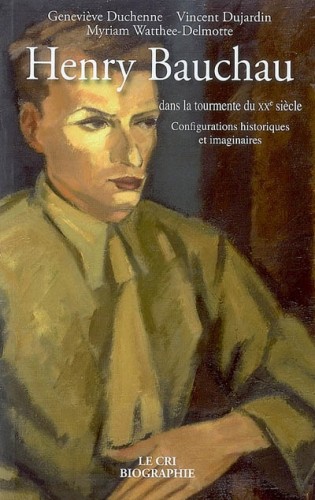 Les tâtonnements de cette génération “non-conformiste” des années 30 ont parfois débouché sur le rexisme, sur un socialisme pragmatique (celui d’Achille Van Acker après 1945), sur une sorte de catho-communisme à la belge (auquel adhérera le Chanoine Leclercq, appliquant avec une dizaine d’années de retard l’ouverture de Maritain et Mounier aux forces socialo-marxistes), sur une option belge, partagée par Bauchau, dans le cadre d’une Europe tombée, bon gré mal gré, sous la férule de l’Axe Rome/Berlin, etc. Après les espoirs d’unité, nous avons eu la dispersion... et le désespoir de ceux qui voulaient porter remède à la déchéance du royaume et de sa sphère politique. Logique: toute politicaillerie, même honnête, finit par déboucher dans le vaudeville, dans un “monde de lémuriens” (dixit Ernst Jünger). Mais c’est faire bien basse injure à ces merveilleux animaux malgaches que sont les lémuriens, en osant les comparer au personnel politique belge d’après-guerre (où émergeaient encore quelques nobles figures comme Pierre Harmel, lié d’amitié à Bauchau) pour ne pas parler du cortège de pitres, de médiocres et de veules qui se présenteront aux prochaines élections... Plutôt que le terme “lémurien”, prisé par Jünger, il aurait mieux valu user du vocable de “bandarlog”, forgé par Kipling dans son “Livre de la Jungle”.
Les tâtonnements de cette génération “non-conformiste” des années 30 ont parfois débouché sur le rexisme, sur un socialisme pragmatique (celui d’Achille Van Acker après 1945), sur une sorte de catho-communisme à la belge (auquel adhérera le Chanoine Leclercq, appliquant avec une dizaine d’années de retard l’ouverture de Maritain et Mounier aux forces socialo-marxistes), sur une option belge, partagée par Bauchau, dans le cadre d’une Europe tombée, bon gré mal gré, sous la férule de l’Axe Rome/Berlin, etc. Après les espoirs d’unité, nous avons eu la dispersion... et le désespoir de ceux qui voulaient porter remède à la déchéance du royaume et de sa sphère politique. Logique: toute politicaillerie, même honnête, finit par déboucher dans le vaudeville, dans un “monde de lémuriens” (dixit Ernst Jünger). Mais c’est faire bien basse injure à ces merveilleux animaux malgaches que sont les lémuriens, en osant les comparer au personnel politique belge d’après-guerre (où émergeaient encore quelques nobles figures comme Pierre Harmel, lié d’amitié à Bauchau) pour ne pas parler du cortège de pitres, de médiocres et de veules qui se présenteront aux prochaines élections... Plutôt que le terme “lémurien”, prisé par Jünger, il aurait mieux valu user du vocable de “bandarlog”, forgé par Kipling dans son “Livre de la Jungle”.
Après l’effondrement belge et français de mai-juin 1940, Bauchau voudra créer le “Service des Volontaires du Travail de Wallonie” et le maintenir dans l’option belge, “fidelles au Roy jusques à porter la besace”. Cette fidélité à Léopold III, dans l’adversité, dans la défaite, est l’indice que les hommes d’”esprit nouveau”, dont Bauchau, conservaient l’espoir de faire revivre la monarchie et l’entité belges, toutefois débarrassée de ses corruptions partisanes, dans le cadre territorial inaltéré qui avait été le sien depuis 1831, sans partition aucune du royaume et en respectant leurs serments d’officier (Léopold III avait déclaré après la défaite: “Demain nous nous mettrons au travail avec la ferme volonté de relever la patrie de ses ruines”). Animés par la volonté de concrétiser cette injonction royale, les “Volontaires du travail” (VT) portaient un uniforme belge et un béret de chasseur ardennais et avaient adopté les traditions festives, les veillées chantées, du scoutisme catholique belge, dont beaucoup étaient issus. Les VT accompliront des actions nécessaires dans le pays, des actions humbles, des opérations de déblaiement dans la zone fortifiée entre Namur et Louvain dont les ouvrages défensifs étaient devenus inutiles, des actions de secours aux sinistrés suite à l’explosion d’une usine chimique à Tessenderloo, suite aussi au violent bombardement américain du quartier de l’Avenue de la Couronne à Etterbeek (dont on perçoit encore les traces dans le tissu urbain). Le “Front du Travail” allemand ne tolèrait pourtant aucune “déviance” par rapport à ses propres options nationales-socialistes dans les parties de l’Europe occupée, surtout celles qui sont géographiquement si proches du Reich. Les autorités allemandes comptaient donc bien intervenir dans l’espace belge en dictant leur propre politique, marquée par les impératifs ingrats de la guerre. Par l’intermédiaire de l’officier rexiste Léon Closset, qui reçoit “carte blanche” des Allemands, l’institution fondée par Bauchau et Teddy d’Oultremont est très rapidement “absorbée” par le tandem germano-rexiste. Bauchau démissionne, rejoint les mouvements de résistance royalistes, tandis que De Becker, un peu plus tard, abandonne volontairement son poste de rédacteur en chef du “Soir” de Bruxelles, puis est aussitôt relégué dans un village bavarois, où il attendra la fin de la guerre, avec l’arrivée des troupes africaines de Leclerc. L’option “belge” a échoué (Bauchau: “si cela [= les VT] fut une erreur, ce fut une erreur généreuse”). La belle Cité éthique, tant espérée, n’est pas advenue: des intellectuels inégalés comme Leclercq ou Marcel de Corte tenteront d’organiser l’UDB catho-communisante puis d’en sortir pour jeter les bases du futur PSC. En dépit de son engagement dans la résistance, où il avait tout simplement rejoint les cadres de l’armée, de l’AS (“Armée Secrète”) de la région de Brumagne, Bauchau est convoqué par l’auditorat militaire qui, imperméable à toutes nuances, ose lui demander des comptes pour sa présence active au sein du directorat des “Volontaires”. Il n’est pas jugé mais, en bout de course, à la fin d’un parcours kafkaïen, il est rétrogradé —de lieutenant, il redevient sergent— car, apparemment, on ne veut pas garder des officiers trop farouchement léopoldistes. Dégoûté, Bauchau s’exile. Une nouvelle vie commence. C’est la “déchirure”.
Comme De Becker, croupissant en prison, comme Hergé, comme d’autres parmi les “Volontaires”, dont un juriste à cheval entre l’option Bauchau et l’option rexiste, dont curieusement aucune source ne parle, notre écrivain en devenir, notre ancien animateur de la “Cité chrétienne”, notre ancien maritainiste qui avait fait le pèlerinage à Meudon chez le couple Raïssa et Jacques Maritain, va abandonner l’aire intellectuelle catholique, littéralement “explosée” après la seconde guerre mondiale et vautrée depuis dans des compromissions et des tripotages sordides. Cela vaut pour la frange politique, totalement “lémurisée” (“bandarloguisée”!), comme pour la direction “théologienne”, cherchant absolument l’adéquation aux turpitudes des temps modernes, sous le fallacieux prétexte qu’il faut sans cesse procéder à des “aggiornamenti” ou, pour faire amerloque, à des “updatings”. L’éparpillement et les ruines qui résultaient de cette explosion interdisait à tous les rigoureux de revenir dans l’un ou l’autre de ces “aréopages”: d’où la déchristianisation post bellum de ceux qui avaient été de fougueux mousquetaires d’une foi sans conformismes ni conventions étouffantes.
L’itinéraire du Bauchau progressivement auto-déchristianisé est difficile à cerner, exige une exégèse constante de son oeuvre poétique et romanesque à laquelle s’emploient Myriam Watthée-Delmotte à Louvain-la-Neuve et Anne Neuschäfer auprès des chaires de philologie romane à Aix-la-Chapelle. Le décryptage de cet itinéraire exige aussi de plonger dans les méandres, parfois fort complexes, de la psychanalyse jungienne des années 50 et 60. Les deux philologues analysent l’oeuvre sans escamoter le passé politique de l’auteur, sans quoi son rejet de la politique, de toute politique (à l’exception d’une sorte de retour bref et éphémère par le biais d’un certain maoïsme plus littéraire que militant) ne pourrait se comprendre: c’est la “déchirure”, qu’il partage assurément, mutatis mutandis, avec De Becker et Hergé, “meurtrissure” profonde et déstabilisante qu’ils chercheront tous trois à guérir via une certaine interprétation et une praxis psychanalytiques jungiennes, une “déchirure” qui fait démarrer l’oeuvre romanesque de Bauchau, d’abord timidement, dès la fin des années 40, sur un terreau suisse d’abord, où une figure comme Gonzague de Reynold, non épurée et non démonisée vu la neutralité helvétique pendant la seconde guerre mondiale, n’est pas sans liens intellectuels avec le duo De Becker/Bauchau et, surtout, évolue dans un milieu non hostile, mais dont la réceptivité, sous les coups de bélier du Zeitgeist, s’amoindrira sans cesse.
Bauchau va donc rompre, mais difficilement, avec son milieu d’origine, celui d’une certaine bourgeoisie catholique, où l’on forçait les garçons à refouler leurs aspirations artistiques ou poétiques: ce n’était pas “viril” d’écrire des poèmes ou de devenir “artiste-peintre”. Bauchau constate donc, en s’analysant, avec l’aide des thérapeutes jungiens, qu’il s’est joué une comédie, qu’il a été en somme un “autre que lui-même”. Ce n’était pas le cas d’Hergé; celui-ci a bel et bien été lui-même dans la confection de ses bandes dessinées —tâche quotidienne, modeste et harassante— mais sa première épouse, Germaine Kiekens, ne prenait pas le métier de son mari au sérieux car, d’après elle, il manquait de panache: selon Philippe Goddin, le biographe le plus autorisé d’Hergé, elle préférait les hommes d’action au verbe haut, tranché et gouailleur, comme l’Abbé Wallez ou même Léon Degrelle, à son “manneken” de dessinateur, timide et discret. Ce n’est effectivement pas “viril”, dans la logique viriliste du bourgeoisisme (catholique comme libéral), de dessiner des personnages pour enfants.
L’exil, volontaire chez Bauchau, se résume par une parole d’Oedipe dans son roman “Oedipe sur la route”: “N’importe où, hors de Thèbes!”, explique la philologue louvaniste Myriam Watthée-Delmotte. La Belgique était devenue pour Bauchau ce que Thèbes était pour Oedipe. Myriam Watthée-Delmotte: “Il choisit donc de s’éloigner de ses cadres d’origine, qui ne lui ont valu que le malheur”. Le monde transparent qu’il a voulu avant-guerre, tout de propreté, ou de “blancheur” dira l’analyste jungien d’Hergé, n’existe pas: il n’y a dans la Cité que traîtrises, lâchetés, veuleries, hypocrisies ... Les postures héroïsantes, mâles, altières, religieuses, servantes, de ceux qui veulent y remédier envers et contre tout, et qu’il a voulu prendre lui-même parce qu’il était dans l’air de son temps, ne se diffusent plus dans une société gangrénée: elles sont vues comme un scandale, comme ennemies, comme liées à un ennemi haï et vaincu, même si l’attitude ultime de Bauchau a été de combattre cet ennemi. En d’autres termes, l’idéal d’un engagement de type scout, au nom d’un christianisme modernisé par Maritain et Mounier (que l’ennemi voulait pourtant combattre et abolir), est considéré dans la “Thèbes nouvelle” comme consubstantiel à l’ennemi, parce que non réductible aux postures officielles, imposées par les vainqueurs américains et soviétiques: le scout pense clair et marche droit, ne mâche pas de gomme aromatisée, ne fume pas de clopes made in USA, ne s’engage pas pour satisfaire ses intérêts matériels, n’est pas animé par la rage stérile de vouloir, en tous lieux, faire “table rase” du passé. “Thèbes”, une fois débarrassée de ces scouts, entre dans le processus fatidique où l’idéal ne sera plus Tintin mais où le modèle à suivre et à imiter, sera celui de Séraphin Lampion. La vulgarité et la médiocrité triomphent dans une Cité qui ne veut plus d’élites mais des égaux à l’américaine ou à la soviétique (Séraphin Lampion: “La musique, c’est bien... mais moi, dans la journée, je préfère un bon demi!”).
L’“enfant rieur” souffre toujours...
Dans les années d’immédiat après-guerre, Bauchau se débat contre l’adversité, encaisse mal le fait d’être rétrogradé sergent mais reste fidèle à ses amis d’avant 1940, surtout à celui qui l’avait amené, un jour, à Paris, voir le couple Maritain: il accueille la mère de Raymond De Becker, embastillé et voué aux gémonies, d’abord condamné à mort puis à la détention perpétuelle. Il ne laisse pas à l’abandon la vieille maman désemparée, qui avait accueilli chez elle, à Louvain, les amis de son fils dans le cadre du groupe “Communauté” (dont le futur Félicien Marceau). En 1950, il écrit une lettre bien balancée et poignante à Jacques Maritain pour lui demander de signer une pétition en faveur de la libération anticipée de De Becker. La souffrance d’avoir été littéralement “lourdé” par la Belgique officielle ne s’est jamais éteinte; Jean Dubois, ancien des VT, le rappelle dans un entretien accordé à Myriam Watthée-Delmotte, en évoquant un courrier personnel adressé à Bauchau en 1999: “Cela me fait mal de savoir que tu souffres toujours. Il faut se débarrasser de ce sentiment”. Une fois de plus, c’est par l’écriture que Bauchau tentera d’en sortir, en publiant d’abord “Le boulevard périphérique” (2008), où l’officier SS Shadow (L’ombre) est une sorte de “Grand Inquisiteur” à la Dostoïevski, pour qui le mal est inhérent à la condition humaine et qui se sert sans vergogne des forces de ce mal pour arriver à ses fins. Mieux: c’est en combattant ce mal, même s’il est indéracinable, que l’on s’accomplit comme le héros Stéphane, mort noyé alors que Shadow le poursuivait lors d’une opération commando. Et Shadow de ricaner: “c’est moi qui en a fait un héros, tout en poursuivant mes fins, qui ne sont point naïves”. Dans “L’Enfant rieur” (2011), les personnages des années 30 reviennent à la surface: “Raymond” n’est autre que De Becker, l’“Abbé Leclair” est bien sûr l’Abbé Leclercq et “André Moly” n’est sans doute nul autre qu’André Molitor.
Dans la littérature d’exégèse de l’oeuvre de Bauchau, on n’explicite pas suffisamment la nature de la thérapie qu’il a suivie chez Blanche Reverchon-Jouve, puis chez Conrad Stein. Quelle était cette thérapie dans le cadre général de la psychanalyse en Suisse (avec la double influence de Freud et de Jung)? Quelle méthode (jungienne ou autre) a-t-on employé pour faire revenir Bauchau à ce qu’il était vraiment au fond de lui-même? Quelle est la pensée psychanalytique de ce Babinski qui fut le maître de Blanche la “Sybille”, fille d’un condisciple français de Freud quand celui-ci étudait auprès de Charcot? Le résultat est effectivement que Bauchau, guéri pour une part de ses tourments, va désormais vivre ce qu’il a toujours voulu vivre au fond de soi, comme De Becker va accepter, grâce à ses lectures de prison, son homosexualité qu’il avait été obligé d’occulter dans les milieux qu’il avait fréquentés. Hergé, pour sa part, va refouler le “blanc” qui le structurait, qui envahissait son intériorité, au point, justement, de ne pas voir ou de ne pas accepter comme faits de monde, les travers infects de l’espèce humaine. Hergé, toutefois, va extraire de lui-même le “diamant pur” (dixit De Becker) et chanter l’indéfectible amitié entre les hommes, entre son Tintin et le personnage de Tchang, au-delà des césures et déchirures qu’imposent les vicissitudes politiques qui ravagent la planète et empêchent les hommes d’être eux-mêmes, de se compléter via leurs affinités électives, comme Tchang l’artiste-sculpteur, disciple chinois de Rodin, avait communiqué à Hergé quelques brillantes techniques de dessin. Bauchau constatera que la trahison, inscrite dans l’âme noire de l’humanité, domine les événements et qu’il est donc impossible de vivre l’éthique pure, “blanche” (l’âme pure, symbolisée par le cheval blanc de Platon), car elle se heurtera toujours à cet esprit malin tissé de trahisons, de méchancetés, de calculs sordides, à l’axiomatique (libérale) des intérêts bassement personnels (axiomatique que l’on considère désormais comme la seule assise possible de la démocratie, comme la seule anti-éthique autorisée, sous peine de basculer dans le “politiquement incorrect” et de subir les foudres des inquisiteurs). Tous les discours sur l’éthique, comme il en a été tenus dans les milieux fréquentés par Bauchau et De Becker avant-guerre, sont condamnés à n’être plus que des discours de façade, tenus par des professeurs hypocrites, des discours entachés de tous les miasmes générés par les mésinterprétations des “droits de l’homme”: ceux qui refusent les abjections de l’âme noire n’ont alors plus qu’une chose à faire, se tourner vers les arts, la poésie, les belles-lettres. Et ne doivent donc plus suivre l’Abbé Leclercq et ses avatars politiciens ou les clercs “aggiornamentisés”, qui déçoivent Bauchau et d’autres de ses anciens adeptes en tentant d’articuler un catho-communisme maritaino-mouniériste dans les années 45-50 puis en montant un PSC social-chrétien, appelé à gouverner de préférence avec les socialistes, quitte à perdre, au fil du temps et au fur et à mesure que les églises se vidaient, son aile droite, qui rejoindra en bonne partie les libéraux, quitte à sacrifier à tous les pragmatismes de piètre envergure pour terminer dans la “plomberie” d’un De Haene ou dans le festivisme délirant d’une Joëlle Milquet.
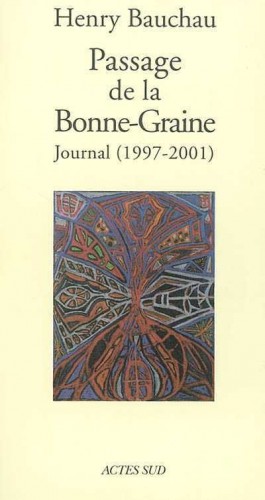 Lao-Tseu, Heidegger et Alain
Lao-Tseu, Heidegger et Alain
Après son analyse sous la houlette thérapeutique de Blanche Reverchon-Jouve, de 1947 à 1949, après ses débuts en poésie, après ses premiers romans, Bauchau se révèle, comme Ernst Jünger, à qui il adresse de temps en temps un salut amical, un mémorialiste de très bonne compagnie littéraire: ses “Journaux” sont captivants, on y glane, sereinement, calmement, une belle quantité de “vertus” qui renforcent l’âme. Personnellement, j’ai beaucoup apprécié “La Grande Muraille – Journal de la Déchirure (1960-1965)” et “Passage de la Bonne-Graine – Journal (1997-2001)”. Dans “La Grande Muraille”, en date du 18 novembre 1961, on peut lire: “Dans mon horizon jusqu’ici la mort, si elle existe, n’a pas eu tant de place. Pourquoi? Peut-être parce que j’ai vécu autrement la guerre, qui, à côté de l’horreur, a été pour moi une époque d’espérance. J’étais soutenu par une force vitale puissante qui ne me permettait pas de croire vraiment à ma mort. Après la guerre c’est le désir de réussite, puis l’échec, qui ont été mes sentiments dominants. L’échec m’a paru pire que la mort”. Résumé poignant, sans explications inutiles, du destin de Bauchau. Le 23 novembre de la même année, on lit cette phrase de Lao-Tseu: “Celui qui connaît sa clarté se voile en son obscur”. Puis celle de Heidegger: “Ce qui ne veut que luire n’éclaire pas”. Toute la démarche post bellum de Bauchau s’y trouve: l’attitude altière du chef des VT est toute de clarté mais ignore sa part obscure (celle aussi de Shadow et du dictateur tudesque que ce personnage du “Boulevard périphérique” servait), une part obscure que l’analyse révèlera. En 1962, Bauchau fait la découverte d’Alain (une découverte qu’il partageait d’ailleurs avec Henri Fenet, sans connaître ce dernier, bien évidemment). Pour notre ancien des VT, Alain est le philosophe qui ne démontre pas, qui ne réfute pas ses homologues, mais “qui les suit, les croit sur parole, apprend d’eux jusque dans leurs erreurs” (6 janvier 1962). Alain incite Bauchau à abandonner toute posture expliquante, toute volonté de démontrer quoi que ce soit. Bauchau: “Alain me montre que je me suis trop occupé de moi, et pas assez du monde” (27 février 1962). Et le même jour: “La définition que donne Alain du bourgeois, l’homme qui doit convaincre, et du prolétaire, l’homme qui produit et qui a la sagesse et les limites de l’outil, est saisissante”. Bauchau dit adieu à sa classe bourgeoise qui, dans le Namurois de ses origines, dans le Bruxelles qui deviendra la “tache grise” de son existence, avait opté pour des postures catholiques, non républicaines au sens français du terme, toutes postures étrangères au réel concret, tissées qu’elles étaient de dérives donquichottesques ou matamoresques. “Le goût de l’explication est le grand obstacle. Se rapprocher de la nudité, de l’image et du fait intérieur, lui laisser son abrupt” (4 mars 1962). “... de dix-huit à trente-quatre ans j’ai vécu ma vie comme une grande aventure. Je juge aujourd’hui qu’elle fut mal fondée et sans issue. N’empêche qu’il y avait une vérité dans ce flux qui me soulevait et que parfois je retrouve dans les moments de création. J’étais aveugle, ligoté par le milieu et mes propres erreurs, mais j’ai vécu une aventure dont je dois retrouver le sens obscur pour accomplir ce que je suis. Il y a une justice que je ne puis encore me rendre car ma vue est encore offusquée par mes erreurs et leurs suites” (9 mars 1962).
On le voit, la lecture des journaux de Bauchau est le complément idéal, et, pour les Wallons ou les Belges francophones, “national”, de la lecture des “Strahlungen” et des volumes intitulés “Siebzig verweht” d’Ernst Jünger. Il y a d’ailleurs un parallèle évident dans la démarche des deux hommes, l’un plongé dans les polémiques politiques de la République de Weimar, l’autre dans celles de la Belgique des années 30; ensuite, tous deux opèrent un repli sur les profondeurs de l’âme ou de la spiritualité, sur fond d’exil, avec les voyages de l’Allemand (au Brésil, en Méditerranée...) et l’éloignement volontaire de “Thèbes” du Wallon, en Suisse puis à Paris. Dans “Passage de la Bonne-Graine”, Bauchau, à la date du 11 septembre 2001, écrit, à chaud, quelques instants après avoir appris les attentats contre les tours jumelles de Manhattan: “L’état du monde sera sans doute changé par cette catastrophe. La guerre ne sera plus faite par des soldats mais par n’importe qui, maniant sans vraie direction politique des armes toujours plus puissantes. Ce ne sera plus l’armée adverse mais les fragiles structures des grandes villes mal protégées qui deviendront les objectifs des terroristes ou résistants. Comme Ernst Jünger l’a prévu, nous risquons d’aller vers la guerre de tous contre tous, dans un nihilisme croissant que cherchent à nous masquer le progrès foudroyant mais immaîtrisé des techniques et la dictature de la Bourse sur des chimères de chiffres, de peurs et d’engouements”. Le 19 septembre 2001, Bauchau note: “... la tristesse des événements d’Amérique et des redoutables lendemains qui s’annoncent si les dirigeants américains s’engagent dans le cycle fatal des vengeances”.
Le 4 octobre 2001: “Dans le dangereux glissement du monde vers l’assouvissement des désirs, la consommation, la technique, je puis à ma petite place rester fidèle à la vie intérieure et à la vérité artisanale de l’art vécu comme un chemin”. Puis, le 19 octobre, ce message politique que nous pouvons faire nôtre et qui renoue paisiblement, subrepticement, avec l’engagement non-conformiste des années 30: “Dans le ‘Monde’ du 18, un article de Francis Fukijama (sic) qui a annoncé il y a quelque années dans un livre la fin de l’histoire. Il soutient malgré les événements la même thèse, pour lui ‘le progrès de l’humanité au cours des siècles va vers la modernité que caractérisent des institutions telles que la démocratie libérale et le capitalisme (...). Car au-delà de la démocratie libérale et des marchés, il n’existe rien d’autre vers quoi aspirer, évoluer, d’où la fin de l’histoire’. La confusion entre la démocratie et le capitalisme est pour lui totale, alors qu’on peut se demander s’ils ne sont pas en réalité opposés. Considérer qu’il n’y a pas d’autre espérance que l’économie libérale et le marché me semble précisément tuer l’espérance, ce qui caractérise bien notre monde. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une ou plusieurs nouvelles espérances, mais pas de celles qu’on tente —en excitant nos désirs— de nous vendre”. En dépit de son constat, fin des années 40, de l’impossibilité d’articuler un quelconque espoir par une revendication tout à la fois politique et éthique, Bauchau, à 88 ans, garde finalement un certain espoir, l’espoir en un retour d’une éventuelle nouvelle vague éthique, en un retour du sacré (bien que non chrétien désormais), en l’avènement d’une synthèse alliant peut-être Confucius, Bouddha et Maître Eckhart, une synthèse portant sur ses ailes un projet politique non démocrato-capitaliste. En formulant furtivement cet espoir, Bauchau cesse-t-il de penser dans la “déchirure”, cesse-t-il, fût-ce pour un très bref instant, fût-ce pour l’instant fugace d’un souvenir, fût-ce pour quelques secondes de nostalgie, de placer ses efforts d’écrivains dans l’espace béant de la “déchirure” permanente, comme le lui avait demandé Blanche Reverchon-Jouve, et renoue-t-il ainsi, pendant quelques minuscules fragments de temps, avec l’idéal de la “réconciliation”, entre catholiques et socialistes, entre “croyants” et “incroyants”? Retour à la case départ? Indice d’un non reniement? Assurément, mais cette fois dans la quiétude.
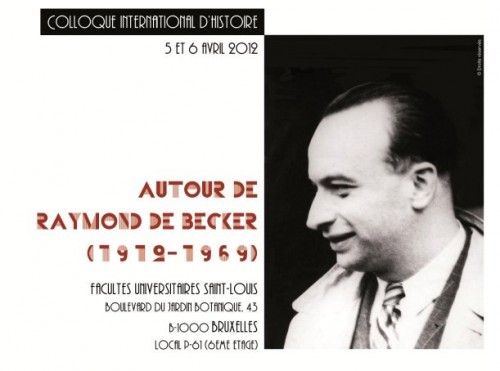
Reste à inciter un chacun à lire le dernier beau recueil de poèmes de Bauchau, “Tentatives de louange” (octobre 2011). La boucle est désormais bouclée: le dernier grand personnage de notre non-conformisme des années 30 vient de franchir la ligne entre notre en-deça et un hypothétique au-delà. Il a réussi sa vie, malgré ses hésitations, malgré ses doutes et, mieux, ceux-ci l’ont aidé à accéder à l’immortalité du poète et de l’écrivain: l’université le célèbre, on l’étudie, il s’est taillé, comme Jünger, une niche dans notre espace culturel. Mieux, il est resté admirablement fidèle à son ami maudit, à Raymond De Becker, qu’il n’a jamais laché, comme il le lui avait promis avant-guerre, lors d’une retraite à Tamié en Savoie. L’Université a organisé enfin un colloque, en avril dernier, sur les multiples facettes de ce personnage hors du commun que fut De Becker, ce “passeur”, cet homme qui s’ingéniait à créer des “passerelles” pour faire advenir une meilleure politique et sortir de la cacocratie, ce proscrit mort dans la solitude et le dénuement en 1969. Le Lieutenant Bauchau a accompli sa principale mission, celle d’être fidèle à son serment de Tamié. Nous ne le dégraderons donc pas, pour notre part, car, sur ce chapitre, court et modeste mais intense et poignant, il n’a pas démérité. Il a sûrement appris la tenue de ce colloque sur De Becker aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles, il a donc su, dans les quatre ou cinq derniers mois de sa vie, que son ami avait été quelque peu “réhabilité”: Henry Bauchau peut dormir en paix et les deux amis, jadis en retraite à Tamié, ne seront pas oubliés car ils auront planté l’arbre de leur espoirs (éthico-politiques) et de leurs aspirations à la quiétude, à une certaine harmonie taoïste, dans le jardin de l’avenir, celui auquel les forces catamorphiques du présentisme t du “bougisme” (Taguieff) n’ont pas accès, ne veulent avoir accès, tant elles mettent l’accent sur les frénésies activistes ou acquisitives. Pour l’avenir, nous nous mettrons humblement à la remorque du Lieutenant Bauchau car la politicaillerie a aussi laissé en nous des traces d’amertume sinon des “déchirures”, certes bien moins tragiques et qui ont suscité plutôt notre verve caustique ou notre morgue hautaine que notre désespoir, zwanze bruxelloise et souvenir d’ “Alidor” obligent. Passons à l’écriture. Passons à la méditation, notamment par le biais de ses “journaux” comme nous le faisons depuis tant d’années en lisant et relisant ceux d’Ernst Jünger.
Robert STEUCKERS.
(Forest-Flotzenberg, septembre/octobre 2012).
Bibliographie:
Oeuvres d’Henry Bauchau:
- Tentatives de louange, Actes Sud, Paris, 2011.
- Le Boulevard périphérique, Actes Sud, Paris, 2008.
- La Grande Muraille – Journal de la ‘Déchirure’ (1960-1965), Actes Sud, 2005.
- Oedipe sur la route, Actes Sud, Paris, 1990.
- Passage de la Bonne-Graine – Journal (1997-2001), Actes Sud, Paris, 2002.
- Diotime et les lions, Actes Sud, Paris, 1991.
- Antigone, Actes Sud, Paris, 1997.
- Poésie, Actes Sud, Paris, 1986.
- L’enfant rieur, Actes Sud, Paris, 2011.
Sur Henry Bauchau:
- Myriam WATTHEE-DELMOTTE, Bauchau avant Bauchau – En amont de l’oeuvre littéraire, Academia/Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2002.
- Geneviève DUCHENNE, Vincent DUJARDIN, Myriam WATTHEE-DELMOTTE, Henry Bauchau dans la tourmente du XX° siècle – Configurations historiques et imaginaires, Le Cri, Bruxelles, 2008.
- Marc QUAGHEBEUR (éd.), Les constellations impérieuses d’Henry Bauchau, Actes du Colloque de Cerisy (21-31 juillet 2001), AML-Editions/Editions Labor, Bruxelles, 2003. Dans ces actes lire surtout:
- A) Anne NEUSCHÄFER, “De la ‘Cité chrétienne’ au ‘Journal d’un mobilisé’”, p. 47-77.
- B) Marc QUAGHEBEUR, “Le tournant de la ‘Déchirure’”, pp. 86-141.
Sur le contexte politique:
- Eva SCHANDEVYL, Tussen revolutie en conformisme – Het engagement en de netwerken van linkse intellectuelen in België – 1918-1956, ASP, Brussel, 2011.
00:25 Publié dans Belgicana, Biographie, Histoire, Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommages, belgicana, belgique, littérature, littérature belge, littérature française, lettres, lettres belges, lettres françaises, histoire, années 30, henry bauchau, raymond de becker |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

00:10 Publié dans Evénement, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paris, france, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, richard millet |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

00:06 Publié dans Evénement, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : événement, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, céline, paris, exposition |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
00:05 Publié dans Littérature, Livre, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cahier de l'herne, roger nimier, france, hussards, littérature, littérature française, lettrees, lettres françaises, années 50 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Ex: http://lepetitcelinien.blogspot.com/
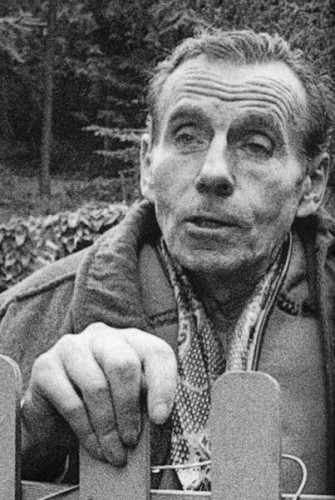 Le refus de souscrire aux codes linguistiques et culturels qui fondent la lisibilité du roman bourgeois caractérise l' « intentionnalité » des écrits céliniens. Nous plaçons le mot entre guillemets parce qu'il ne fait que renvoyer à l'appréciation de l'écrivain sur sa pratique littéraire. Sans augurer du niveau d'objectivité qu'elle manifeste, il nous faut d'entrée de jeu constater que cette évaluation fut corroborée par le public et sanctionnée par le désintérêt dans lequel sont tombées les dernières productions céliniennes : Guignols Band, Le Pont de Londres, D'un Château l'autre et plus encore Rigodon, Nord ou Féerie pour une autre fois sont actuellement des textes « illisibles ».
Le refus de souscrire aux codes linguistiques et culturels qui fondent la lisibilité du roman bourgeois caractérise l' « intentionnalité » des écrits céliniens. Nous plaçons le mot entre guillemets parce qu'il ne fait que renvoyer à l'appréciation de l'écrivain sur sa pratique littéraire. Sans augurer du niveau d'objectivité qu'elle manifeste, il nous faut d'entrée de jeu constater que cette évaluation fut corroborée par le public et sanctionnée par le désintérêt dans lequel sont tombées les dernières productions céliniennes : Guignols Band, Le Pont de Londres, D'un Château l'autre et plus encore Rigodon, Nord ou Féerie pour une autre fois sont actuellement des textes « illisibles ».
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, lettres, lettres françaises, france, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
00:05 Publié dans Entretiens, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, céline, fabrice luchini |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
00:07 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, céline, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
17:13 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, céline, france, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Nous remercions l'auteur d'avoir bien voulu nous faire partager ce texte.
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, lettres norvégiennes, lettrezsscandinaves, littérature norvégienne, littérature scandinave, céline, knut hamsun |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
XIXè Colloque international Louis-Ferdinand Céline du 6 au 8 juillet 2012 à Berlin
Le dix-neuvième Colloque international Louis-Ferdinand Céline, organisé par la Société d'études céliniennes, se déroulera du 6 au 8 juillet 2012 au Frankreich-Zentrum de la Freie Universität de Berlin (Rheinbabenallee 49, Berlin). Voici le programme complet de ces trois journées.
Bianca ROMANIUC-BOULARAND
Figure et espace dans la trilogie allemande et dans Féerie pour une autre fois I
Des collabos aux Balubas : le miroir sonore de l'histoire dans la trilogie allemande
François-Xavier LAVENNE
Orphée en Allemagne : la trilogie, parcours à travers les enfers et quête de l'écriture
12h30 - Assemblée Générale de la Société d'études céliniennes
00:05 Publié dans Evénement, Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : colloque, événement, lettres, lettres françaises, céline, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Jean Prévost, homme libre et rebelle
par Pierre LE VIGAN
Qui connaît encore Jean Prévost ? Assurément plus grand monde. Cet oubli est de prime abord étonnant. Voici un écrivain français, intelligent bien qu’intellectuel, patriote sans être anti-allemand, anti-hitlérien sans être communiste, il fut aussi maquisard et fut tué dans le Vercors durant l’été 44.
La France d’après-guerre a fort peu honoré cet homme, non plus que la France actuelle. L’air du temps est à la contrition mais pas à l’admiration. Jean Prévost a pourtant des choses à nous dire : sur le courage et sur l’intelligence, et sur le premier au service de la seconde comme l’avait rappelé Jérôme Garcin (1).
Dominique Venner écrit de son côté : « Pamphlétaire, critique littéraire et romancier, Jean Prévost venait de la gauche pacifiste et plutôt germanophile. C’est le sort injuste imposé à l’Allemagne par les vainqueurs de 1918 qui avait fait de lui, à dix-huit ans, un révolté. Depuis l’École normale, Prévost était proche de Marcel Déat. Il fréquentait Alfred Fabre-Luce, Jean Luchaire, Ramon Fernandez. À la fin des années Trente, tous subirent plus ou moins l’attrait du fascisme. Tous allaient rêver d’une réconciliation franco-allemande. Tous devaient s’insurger contre la nouvelle guerre européenne que l’on voyait venir à l’horizon de 1938. Lui-même ne fut pas indifférent à cet « air du temps ». En 1933, tout en critiquant le « caractère déplaisant et brutal » du national-socialisme, il le créditait de certaines vertus : « le goût du dévouement, le sens du sacrifice, l’esprit chevaleresque, le sens de l’amitié, l’enthousiasme… (2) ». Une évolution logique pouvait le conduire, après 1940, comme ses amis, à devenir un partisan de l’Europe nouvelle et à tomber dans les illusions de la Collaboration. Mais avec lui, le principe de causalité se trouva infirmé. « Il avait choisi de se battre. Pour la beauté du geste peut-être plus que pour d’autres raisons. Il tomba en soldat, au débouché du Vercors, le 1er août 1944. (3) ».
Jean Prévost est d’abord un inclassable : ni communiste, ni catholique, ni même communiste-catholique comme beaucoup, rationnel sans être rationaliste, progressiste sans être populiste au sens démagogique, patriote sans être nationaliste. Un intellectuel nuancé et, dans le même temps, un homme privé vif, tourmenté, sanguin, passionné, exigeant vis-à-vis de lui-même. Un aristocrate. Stendhal dont Prévost fut un bon spécialiste disait que le « vrai problème moral qui se pose à un homme comblé » est : « que faire pour s’estimer soi-même ? ». Jean Prévost fit sien ce problème. Pour y répondre, il « raturait sa vie plutôt que son œuvre ». Et il se « dispersait » dans une multiplicité de centres d’intérêt : critique littéraire, cosmologie et polémologie, philosophie du droit et architecture… En fait, Jean Prévost foisonnait. Sa pseudo-dispersion était profusion. « Jamais de ma vie je n’ai pu rester un jour sans travailler. »
Éloigné de tout dandysme, Jean Prévost veut savoir pour connaître. Son travail intellectuel est ainsi un « rassemblement » de lui-même, une mise en forme de son être, qui se manifeste par des prises de position rigoureuses et souvent lucides. Grand travailleur tout autant que grand sportif, Jean Prévost attend que le sport lui fournisse « ce bonheur où tendait autrefois l’effort spirituel ». C’est aussi pour lui un antidote à la civilisation moderne. « Les Grecs, écrit-il, s’entraînaient pour s’adapter à leur civilisation. Nous nous entraînons pour résister à la nôtre. »
Malgré la diversité de ses dons, Prévost évoque le mot de Stendhal sur ceux qui « tendent leur filet trop haut ». Il fait partie de ceux qui « pêchent par excès ». Mais c’est un moindre défaut car, comme Roger Vaillant le dit à propos de Saint-Exupéry, « l’action le simplifie ». Et Prévost est un homme d’action. Jean Prévost est aussi aidé par une idée simple et robuste de ses devoirs et de ce qui a du sens dans sa vie : le plaisir, l’amour de ses enfants, les amis, le souci de l’indépendance de son pays.
 Trop païen pour ne pas trouver que la plus détestable des vertus – ou le pire des vices – est la « reconnaissance » envers autrui, trop français pour ne pas avoir le sens de l’humour, « décompliqué des nuances », mais plein de finesse et de saillies (en cela nietzschéen). Jean Prévost se caractérise aussi par la temporalité rapide de son écriture qui est celle du journalisme. C’est ce sens du temps présent qui l’amène (tout comme Brasillach, mais selon des modalités fort différentes), à l’engagement radical, c’est-à-dire, dans son cas, à la lutte armée contre les Allemands dans le maquis du Vercors. C’est là que cet homme, multiple, entier, solaire, trouva sa fin. Il avait écrit : « il manque aux dieux-hommes ce qu’il y a peut-être de plus grand dans le monde; et de plus beau dans Homère : d’être tranché dans sa fleur, de périr inachevé; de mourir jeune dans un combat militaire ».
Trop païen pour ne pas trouver que la plus détestable des vertus – ou le pire des vices – est la « reconnaissance » envers autrui, trop français pour ne pas avoir le sens de l’humour, « décompliqué des nuances », mais plein de finesse et de saillies (en cela nietzschéen). Jean Prévost se caractérise aussi par la temporalité rapide de son écriture qui est celle du journalisme. C’est ce sens du temps présent qui l’amène (tout comme Brasillach, mais selon des modalités fort différentes), à l’engagement radical, c’est-à-dire, dans son cas, à la lutte armée contre les Allemands dans le maquis du Vercors. C’est là que cet homme, multiple, entier, solaire, trouva sa fin. Il avait écrit : « il manque aux dieux-hommes ce qu’il y a peut-être de plus grand dans le monde; et de plus beau dans Homère : d’être tranché dans sa fleur, de périr inachevé; de mourir jeune dans un combat militaire ».
Pierre Le Vigan
Notes
1 : Jérôme Garcin, Pour Jean Prévost, Gallimard, 1994.
2 : Idem.
3 : Dominique Venner, dans La Nouvelle Revue d’Histoire, n° 47, 2010.
• Publié initialement dans Cartouches, n° 8, été 1996, remanié pour Europe Maxima.
Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com
00:05 Publié dans Histoire, Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, résistance, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, jean prevost |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

En ce temps-là, tout anticommuniste était un chien. Achat obligé en Chine sous peine de travaux forcés, le Petit Livre Rouge se vendait comme des petits pains à Saint-Germain-des-Prés. Philippe Sollers s’exaltait à traduire les poèmes du Grand Timonier dans Tel Quel. Et parce qu’il avait osé le premier un essai critique sur la Révolution culturelle avec Les Habits neufs du président Mao (1971), la sinologue maoïste Michelle Loi ne trouvait rien de plus honnête que de révéler le véritable patronyme de Simon Leys dès le titre de son libelle contre lui Pour Luxun. Réponse à Pierre Ryckmans (Simon Leys), espérant ainsi que celui-ci devienne persona non grata en Chine. Il est vrai que l’on ne s’en prenait pas comme ça à la « Révo. Cul. » et à ses laudateurs dont Jean-François Revel dirait plus tard que s’ils n’avaient pas de sang sur les mains, ils en avaient sur la plume.
Autant le négationnisme nazi arriva après le nazisme, autant le négationnisme stalinien et maoïste commença tout de suite, et non par le biais de quelques extrémistes délirants et isolés, du reste immédiatement exclus des thébaïdes intellectuelles mais bien par celui de l’ensemble des maîtres-censeurs du Flore et dont certains sont toujours honorés sur les plateaux de télévision, tel l’inoxydable Alain Badiou qui se donne encore le droit, comme le rappelle, mi-consterné mi-amusé, Leys, d’écrire à propos de Lénine, Staline, Mao, Guevara et autres bienfaiteurs du XXème siècle qu’ « il est capital de ne rien céder au contexte de criminalisation et d’anecdotes ébouriffantes dans lesquelles depuis toujours la réaction tente de les enclore et de les annuler. » Rien que pour cette piqûre de rappel, d’autant plus nécessaire que l’amnésie historique, partie intégrante du programme totalitaire, continue, comme l’a bien vu Frédéric Rouvillois, à être la règle auprès d’un grand nombre d’intellectuels, la lecture de ce Studio de l’inutilité devrait être déclarée d’utilité publique. En vérité, ce Belge qui résista aux tanks de l’intelligentsia des années 70 et suivantes, fut notre homme de Tian’anmen à nous.
Pour autant, l’intérêt de ce Studio n’est pas seulement d’ordre purgatif. Intempestif en politique, Simon Leys l’est tout autant en littérature – et c’est là que le plaisir commence. Esprit curieux, érudit toujours plaisant, il n’est jamais là où on l’attend. Peut-être est-ce dû à cette « belgitude » qui, comme chez Henri Michaux sur lequel s’ouvre ce recueil d’essais, est la marque d’une carence originelle, d’une « conscience diffuse d’un manque » que l’auteur de L’ange et le Cachalot va tenter de compenser par la singularité et le paradoxe – l’inadaptation étant toujours la chance de l’esprit libre. Et l’adaptation trop grande provoque la malchance de l’artiste – celle qui finira par toucher Michaux lui-même qui, en voulant, à la fin de sa vie, corriger son œuvre de sa spontanéité originelle, la gâchera en lui donnant un tour bien trop culturel pour être artistique. C’est qu’entre temps, Michaux sera pour sa gloire et son malheur devenu français – c’est-à-dire à l’époque un intellectuel de gauche se rangeant à l’opinion la plus avantageuse et la plus dépravée, au fond la plus utile, celle qui permet, écrit Simon Leys, de « délivrer des brevets de bonne conduite et des médailles récompensant l’effort méritant, qu’il s’agisse de la Chine de Mao ou du Japon d’après guerre » et qu’il se serait sans doute bien gardé de faire s’il était resté belge.
Se garder de tous les clichés de la « francitude », au risque de perdre les pouvoirs qu’elle donne, telle sera la probité de Simon Leys qui, à l’instar de Simone Weil qu’il admire, choisira toujours la justice plutôt que son camp. En plus de rester fidèle à ses goûts, ce qui dans notre pays où tout le monde aime ou déteste la même chose est aussi une preuve d’héroïsme. Ainsi, lorsqu’Antoine Gallimard et Jean Rouaud le contactent pour savoir quel est pour lui « le roman du XX ème siècle », il ne propose pas, comme tout un chacun, l’énième chef-d’œuvre de Céline, Proust ou Kafka, mais remet à l’honneur d’autres titres moins côtés quoique tout aussi importants, tels Le nommé Jeudi de Chesterton et L’agent secret de Conrad, deux romans qui mettent en scène terroristes et contre-terroristes et qui à leur manière parlent de cette possession révolutionnaire qui fut la marque abominable du XX ème siècle et qu’un Dostoïevski avait déjà anticipée dans ses Possédés. Paradoxe personnel de Leys dont on connaît l’amour de la mer mais qui choisit de Conrad, l’un des plus grands écrivains maritimes s’il en est, le roman le plus urbain, le moins épique, et qui en guise d’eau ne parle que de la pluie londonienne. Mais cohérence métaphysique de Leys qui voit dans cet Agent secret la volonté de Conrad, apatride comme lui, de décrire la terrifiante réalité européenne du début du siècle avec ses conspirations prométhéennes, son nihilisme délirant, sa future violence continentale.
A l’instar de René Girard et de Conrad, Leys est un romantique qui connaît mieux que personne les mensonges du romantisme que seul l’art romanesque peut dévoiler. Y compris ceux qui se mêlent justement de mer et de navigation, sa passion-répulsion. Car la mer réelle n’est pas celle qu’ont fantasmée nombre d’auteurs (et parmi les plus grands comme Baudelaire), en faisant une sorte d’évasion du quotidien, d’horizon paradisiaque, d’aventure féérique comme la rêvait le pauvre Marius dans la trilogie de Pagnol. Non, la vérité que seuls les marins savent mais taisent est que « la mer est invivable ». La mer est stupide, plate, monotone, stérile, cruelle. La mer rappelle que la Nature n’est pas cette bonne maman accueillante sur laquelle se sont pâmés Charles Trenet et Renaud mais bien cette marâtre qui traite sans pitié les hommes et les marins de surcroît. Le « rêve nautique » est plein de noyade, de scorbut, de discipline inhumaine – aussi faux et aussi mortifère que le rêve maoïste. Mais l’amnésie poétique a la vie aussi dure que l’amnésie idéologique. Que sait-on exactement de Magellan et de son voyage aussi héroïque qu’infernal (et qu’il ne termina pas, se faisant tuer à mi-route par des indigènes philippins) ? Au-delà de la performance, indiscutable pour l’époque, de ce premier tour du monde et qui allait changer la donne du monde, « ce que l’expédition démontra – faisant de Magellan l’involontaire ancêtre idéologique de la globalisation, c’est la circumnavigabilité du globe : tous les océans communiquent. »
A partir de Magellan, le monde ne sera en effet plus qu’une affaire de communication, commercialisation, médiatisation, aliénation – et mal de mer. Alors, certes, on peut toujours rêver d’une cité parfaite, comme celle qu’organisèrent pour un temps sur leur île les fameux « naufragés des Auckland » en 1865 (et qui inspirera à Jules Verne quelques années plus tard son Ile mystérieuse), on peut toujours rêver, à l’instar de Simon Leys lui-même, d’une université castalienne où professeurs et étudiants se retrouveraient pour la seule quête de la connaissance pure et de la vérité désintéressée (quoique, rajoute malicieusement l’auteur, « les étudiants constituent un élément important, mais pas toujours indispensable » !), l’on peut toujours imaginer une tour d’ivoire aristocratique dans laquelle se protéger du monde, le problème est que, comme le disait Flaubert, l’on ne pourra jamais éviter cette « marée de merde [qui] en bat les murs, à les faire crouler. » La merde de l’utile, évidemment.
Simon Leys, Le Studio de l’inutilité, Flammarion, 2012.
00:07 Publié dans Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, simon leys |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Un nouveau Bouquin de Synthèse nationale :
Le Dictionnaire des polémistes,
d'Antoine de Rivarol à François Brigneau,
Tout au long de l’année 2011, Robert Spieler a proposé aux lecteurs de Rivarol, l’hebdomadaire de l’opposition nationale et européenne, une série d’articles consacrés aux polémistes qui marquèrent l’histoire de la presse depuis la Révolution française, jusqu’au milieu du XXe siècle. Il reprend ainsi le travail effectué par Pierre Dominique dans son ouvrage publié au début des années 60 (et aujourd’hui épuisé) Les Polémistes français depuis 1789.
Ce Dictionnaire des polémistes rassemble tous ces articles. Vous retrouverez ici les grands noms qui, en leur temps, marquèrent les esprits. Ils n’hésitaient pas à dénoncer les puissants du moment. Beaucoup parmi eux payèrent très cher leur engagement. Aujourd’hui, la liberté d’expression se heurte encore aux ukases du politiquement correct et, comme hier, des lois liberticides, beaucoup plus insidieuses sans doute, empêchent les vrais polémistes de s’exprimer…
Robert Spieler, ancien député, fondateur d’Alsace d’abord, Délégué général de la Nouvelle Droite Populaire, est aussi l’un des journalistes de l’hebdomadaire Rivarol. Chaque semaine il décortique avec délectation et cynisme l’actualité dans sa fameuse Chronique de la France asservie et résistante.
■ Commandez le Dictionnaire des Polémistes :
Règlement à la commande par chèque à l’ordre de Synthèse nationale à retourner à :
Synthèse nationale 116, rue de Charenton 75012 Paris
18, 00 € l’exemplaire (+ 3 € de port)
Bulletin de commande : cliquez ici
00:05 Publié dans Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, littérature, lettres, lettres françaises, france, littérature française, robert spieler |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Ex: http://mediabenews.wordpress.com/